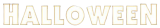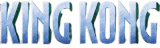Critiques spectateurs de Dante_1984
Pages |
Le Cas 39
Emily, une assistante sociale, recueille chez elle Lilith, une jeune enfant dont les parents ont voulu l’assassiner dans le four de la cuisine. Alors que tout semble se dérouler pour le mieux, les proches d’Emily disparaissent un à un. Petit à petit, Emily découvre que les parents de la n’étaient peut-être pas si fous que cela. Après le terrifiant Pandorum, Christian Alvart quitte l’espace pour nous emmener dans un thriller fantastique où les enfants ont la main mise sur les adultes. Dans quelle époque vivons-nous, si l’on ne peut plus faire autorité sur tous ces sales mioches qui jonchent les rues et les films d’horreur !
Après toute une ribambelle de gamins en mal de reconnaissance et aux troubles psychologiques avancés, Le cas 39 évolue sur une thématique de plus en plus en vogue depuis quelque temps au cinéma. Un terrain fertile pour laisser libre cours aux inquiétantes actions de ces charmants bambins. Toutefois, le film de Christian Alvart semble se démarquer des autres en apportant à son histoire une touche de fantastique parfaitement assumée. En cela, on peut s’interroger sur la véritable identité de Lilith. De là à songer qu’il existe un rapport avec le démon biblique (que l’on a pu voir dans le récent et très bon Evil angel), il n’y a qu’un pas.
Qui mieux que Jodelle Ferland pouvait donner vie à ce personnage inquiétant qui, malgré un visage angélique, fait passer de la pitié à l’effroi les malheureux protagonistes de l’histoire. On avait déjà pu la remarquer dans Tideland ou Silent Hill, nul doute que cette jeune fille dispose d'un talent certain pour transmettre moult émotions aux spectateurs. Néanmoins, il faut signaler quelques errances au niveau du scénario qui ne possède rien de fondamentalement surprenant et qui se complaît à nous offrir un happy-end pas forcément de circonstances. Ajoutons à cela, la séquence des frelons passablement discutable. La faute à des images de synthèses grossières. Utiliser de véritables insectes aurait été plus difficile, mais plus saisissant.
Bref, Le cas 39 est un habile mélange entre La malédiction et Esther. Une plongée infernale dans une paranoïa progressive qui guette le moindre signe de faiblesse pour s’insinuer dans le cerveau de protagonistes bien mal en point face à un démon pour le moins capricieux. Une incursion réussit pour Christian Alvart dans un domaine qui commence à s’encombrer tant au niveau de l’histoire que sur une approche novatrice du genre. Il demeure tout de même un bon moment frissonnant où la jeune Jodelle Ferland brille par son talent à angoisser aussi bien ses partenaires que nous autres, derrière notre petit écran.
Publié le 25 Février 2011
The Interceptor
Dans un avenir proche, un ancien espion reprend du service pour endiguer une menace planétaire. Si rien n’est fait pour contrecarrer les plans d’un politicien véreux et corrompu, les ténèbres régneront sur la Terre. Premier long-métrage de Konstantin Maximov, The interceptor s’annonce comme : « le chaînon manquant entre Le transporteur et Matrix. » Plus loin, l’on décèle sur la jaquette « Par l’équipe de Nightwatch ». Autre référence qui peut être sujette à caution étant donné que ce film ne faisait pas l’unanimité. Un mélange des genres et une comparaison pour le moins audacieuse pour cette nouvelle production russe qui daignent nous faire l’honneur de sa présence avec une sortie DVD doté d’un fort potentiel publicitaire. Il n’en fallait pas plus pour attiser ma curiosité.
Potentiel, il y a ; surtout lorsque l’on constate que l’histoire multiplie les genres. Fantastique, science-fiction, action et fantasy s’entremêle dans l’intrigue, mais l’on remarquera bien vite que cet enchevêtrement ne prend guère. Malgré de bonnes idées que l’on retrouve au début (la notion de la Terre qui n’est pas en osmose avec la volonté de l’univers), l’ensemble s’élime beaucoup trop rapidement pour permettre de créer une mythologie dense dans un univers tout aussi immersif. La faute principalement à un déferlement de séquences où la narration peine à donner un rythme convenable à l’intrigue. Combats au corps-à-corps, fusillades, voltiges surréalistes. Le film s’entiche alors d’un enrobage assez séduisant, mais c’est loin d’être suffisant pour convaincre pleinement.
De fait, il en découle une alternance des points de vue chaotique où les multiples facettes du récit ne prennent jamais consistance. Entre deux séquences d’action où les ralentis foisonnent, les diverses interventions sont d’un intérêt tout discutable. L’apprentissage de Georgiy se révèle beaucoup trop succinct et sa quête, manichéenne au possible, revêt des aspects très conventionnels. Sauver la demoiselle en détresse et tuer le grand méchant pour protéger le monde des ténèbres. Un peu juste pour une production de cet acabit, quand bien même provient-elle de Russie. À noter que le final se moque littéralement du spectateur en coupant court à toute spéculation en pleine action. Il y aura donc une suite, même si on sera loin de l’attendre avec impatience.
Bref, The interceptor privilégie le spectaculaire à la réflexion. On ne peut lui en tenir rigueur, mais quelques plans esthétiquement convaincants ne suffisent pas à pallier de nombreuses errances scénaristiques. Il en résulte une production bancale qui ne sait pas véritablement vers quel chemin se tourner. On ressent un goût d’inachevé compte tenu des multiples formes auxquelles Interceptor épouse au long d’une histoire finalement très classique. Sans jamais trop connaître les intentions du réalisateur, on se perd dans un melting-pot déstabilisant où le bien et le mal s’affrontent une énième fois dans un déluge d’effets spéciaux (assez sympathiques, mais pas tous). Un DTV qui promet de décrocher la Lune, mais ne parvient même pas à escalader le Mont Blanc.
Publié le 23 Février 2011
The Town
Dans le quartier de Charlestown, Doug et ses amis dévalisent les banques et les fourgons de la ville. Une organisation minutieuse qui ne laisse rien au hasard, le vol d’argent se fait rapidement et, la plupart du temps, sans heurt. Seulement Doug tombe amoureux de la directrice de la banque qu’il vient de braquer. Alors qu’un nouveau coup se prépare, le FBI les traque sans relâche. Après l’inoubliable Gone baby gone, Ben Affleck retourne derrière la caméra pour The Town, adaptation du roman de Chuck Hogan.
Fresque contemporaine d’une bande de braqueurs qui vivent sur le fil du rasoir, The town est le genre de polars qui dépeint un tableau personnages des plus attachants et ce, malgré la violence qui anime leur quotidien. Sans ambages, ils se révèlent simplement le reflet d’un quartier laissé pour compte par des institutions qui se contrefichent d’un environnement populaire où la pauvreté s’insinue dans chaque foyer tel une gangrène inexorable. C’est en cela que The town frappe fort : des protagonistes humains qui véhiculent une profonde amertume envers le système. On dénotera également un certain fatalisme dans leur comportement, comme si l’endroit où ils étaient nés détermine leur vie et leur mort.
Bien que les braquages soient le point central autour duquel évoluent les intervenants, l’action n’est pas une part prépondérante du film de Ben Affleck. Au contraire, le réalisateur manie les séquences survoltées et les moments plus posés avec un rare équilibre. La relation avec Claire est également partie prenante dans cette impression générale. Aucun élément, quel qu’il soit, ne prend le pas sur un autre. On se retrouve alors avec un traitement entre drame et thriller. Un jonglage périlleux où il aurait été très facile de se perdre l’un dans l’autre, mais Ben Affleck se sort de cet exercice avec brio.
Bref, The town fera indéniablement pensé à Heat puisqu’il traite des braquages. Il supporte la comparaison tout en se détachant d’une réalisation nerveuse à la Michael Mann pour se concentrer avec une approche plus intimiste sur les personnages. De fait, je songe davantage à Mystic river ou à Gone baby gone (Est-ce un hasard si ces deux romans et films sont l’œuvre de Dennis Lehane ?). The town est avant tout un récit sur le destin et ce que l’on en fait, à bon ou mauvais escient. Ben Affleck confirme qu’il possède la carrure et le talent d’un metteur en scène proche de son histoire et de ses acteurs. Un film que je recommande sans réserve.
Publié le 23 Février 2011
Les Envoutés
Après la mort de sa femme, un psychiatre décide de déménager avec son fils à New York. Rapidement, la police le met sur une affaire où de jeunes adolescents sont sauvagement assassinés dans des sacrifices rituels. Il s’avère qu’une puissante secte se trouve derrière ces horribles meurtres. Adaptation d’un roman qui est passé relativement inaperçu lors de sa sortie, le film de John Schlesinger ne peut se targuer de récolter une meilleure réputation. Rares sont les personnes à s’en souvenir et l’on se demande pourquoi dès les premières images du film. Aussi, on peut se dire que le projet est entre de bonnes mains puisque l’on retrouve derrière la caméra John Schlesinger qui a réalisé entre autres Marathon man ou, par la suite Fenêtre sur Pacifique.
En tête d’affiche, Martin Sheen et Robert Loggia, deux stars hollywoodiennes qui n’ont plus rien à prouver, donnent le tempo à une intrigue à mi-chemin entre le thriller et le film d’épouvante. Le récit se complaît à brouiller les pistes. On décèle certaines séquences surnaturelles où il est difficile de trouver une explication rationnelle (par exemple les serpents dans l’estomac) qui se confronte à Cal Jamison, psychiatre émérite des plus pragmatiques. C’est en cela que l’histoire s’avère intéressante : opposer le cartésianisme le plus exacerbé aux rites et coutumes d’une religion mal connue où s’intègrent pêle-mêle magie vaudou et rite animiste qui s’associe à la religion catholique.
Le cinéaste ménage le suspense afin de permettre à l’intrigue de suivre son cours avec attention. Chaque personnage semble avoir bénéficié d’un soin tout particulier sans jamais léser l’un ou l’autre. Tous possèdent des traits singuliers qui trouveront leur justification en temps et en heure. A cela, on remarquera une ambiance glauque qui habite les recoins les moins recommandables de New York. Les quais, les quartiers malfamés, tout est entrepris pour envelopper l’histoire dans un climat nébuleux à la limite de nos conceptions très terre-à-terre et, parfois, au-delà. Habile mélange entre enquête policière et exploration du monde de l’invisible, le scénario distille une paranoïa latente qui gangrène un à un les protagonistes.
Bref, Les envoûtés demeure un film d’épouvante hautement recommandable. Force est de constater que les vingt-quatre années qui le séparent de sa sortie ne l’ont pas trop vieilli et, mis à part quelques menus écueils pardonnables, on se retrouve avec une production prenante qui a le mérite de traiter son thème avec conviction en optant pour une religion que l’on ne connaît que trop mal. Sans jamais lever le voile de mystères qui occupent le devant de la scène (l’ambiguïté réalité / illusion persiste jusqu’au dénouement sujet à interprétation), l’histoire nous emporte avec une facilité déconcertante dans les méandres de la mégalopole.
Publié le 22 Février 2011
Orbital
En 2068, une station spatiale qui orbite autour de la Lune est assaillit par des terroristes. Le commandant, aidé de ses fidèles compagnons, tentent d’endiguer la menace. Les animes japonais sont, en général, toujours gages d’une certaine qualité. Une patte esthétique inspirée qui transportent le spectateur vers de nouveaux horizons grâce à des films passionnants. Néanmoins, il arrive de tomber sur des productions qui ne possèdent ni l’envergure, ni l’ambition de faire de leur histoire une œuvre inoubliable. Orbital est de ceux là. D’autant plus qu’il faut éclaircir un point avant de commencer à se pencher sur l’histoire en elle-même : Orbital n’est pas un long-métrage.
En effet, Orbital se compose en deux OAV (de 40 minutes). Il n’est donc pas à proprement parlé un film, mais une succession de deux moyens métrages à l’intérêt des plus discutable. La première impression qui en ressort est son design atypique. On pourrait l’apparenter à Appleseed, mais rapidement l’on se rend compte que les animateurs n’ont pas réussi à insuffler au personnage une âme. Un rendu trop synthétique qui manque de vigueur, ainsi que des visages trop amorphes pour susciter la moindre émotion. Froncements de sourcils, regard en coin, voilà toute la panoplie des protagonistes. On a beau essayé de déceler une once de conscience derrière leurs yeux de cristal, mais rien n’y transparaît.
Tout est trop statique, tant les déplacements que le cadrage, dont on soupçonne la fixité pour simplement combler des vides scénaristiques, nous interpellent sur un univers passablement stérile et classique. Rien n’est entrepris pour nous impliquer dans l’histoire ou nous identifier aux personnages, platoniques au possible. On n’échappe pas aux clichés de circonstances et, malheureusement, l’histoire s’avère pour le moins simpliste et sans grand intérêt. Ajoutons à cela, une bande son à l’image du film : discrète et convenue en tout point qui n’offre aucun moment véritablement palpitant. Inutile de mentionner le doublage français, abominable. Des interprètes peu impliqués qui semblent réciter leur texte sous anxiolytique.
Bref, Orbital nous plonge dans une cruelle désillusion. Réalisation minimaliste qui manque d’envergure, une histoire aux relents larmoyants assez pathétiques, sans oublier une certaine confusion qui règne pour faire la jonction entre la première et la seconde partie (sorte de Roméo et Juliette interstellaire absolument ridicule) qui forment Orbital. Ne nous y trompons pas, que cela concerne l’une ou l’autre on ne peut que constater les mêmes défauts, les mêmes errances tant sur le plan scénaristique que technique. Peu inspiré dans la fantastique odyssée qu’est l’exploration de l’univers, Orbital se révèle davantage laborieux qu’immersif. Très moyen, mais surtout décevant.
Publié le 22 Février 2011
Captifs
Trois amis qui travaillent dans l’humanitaire rentrent des Balkans par la route. Contraints de faire un détour (mortel ?), ils sont kidnappés puis séquestrés par des locaux qui se spécialisent dans le trafic d’organes. Première réalisation de Yann Gozlan, Captifs reprend la thématique, déjà très exploitée, du trafic d’organes dans les pays pauvres ou en proie à des conflits qui ont ravagé leur économie en même temps que leur avenir. Toute la question est de savoir si Captifs parvient à nous happer dans son histoire par le biais d’un traitement sans concession qui nous fera frémir au fond de notre fauteuil.
Force est de constater que le scénario ne recèle rien de bien neuf. Certes, l’on pourrait être plus indulgent en se disant qu’il s’agit d’une production française et qu’ils ne sont pas légion à s’aventurer sur pareil terrain. Seulement, ce sujet est tellement « banal » tant dans sa composition que son déroulement, qu’il en faudrait davantage pour susciter de notre part un réel engouement. Introduction biaisée, un rapt violent, mais ordinaire et… la séquestration. Captifs démarre comme le plus classique des films d’horreur. Ce n’est pas pour autant qu’on le condamnera précipitamment, mais à force de ne voir aucune volonté de sortir du lot, ni même une once d’originalité, il faut reconnaître un certain agacement, voire de la résignation dans ce genre de productions.
Aucune surprise au niveau du récit, on se contente d’opter pour une approche très sobre pour un sujet qui se veut choquant et vindicatif par nature. Modéré, Captifs l’est un peu trop. Le réalisateur privilégie davantage l’aspect lancinant de la séquestration plutôt que de sombrer dans le torture-porn de bas étage. De ce côté, on peut se dire que le choix est judicieux, du moins dans les intentions. En effet, les minutes s’égrènent et, mis à part les incursions de notre trio peu scrupuleux, l’intrigue fait du surplace. L’attente de l’inéluctable, véritable torture psychologique, le spectateur l’a subit autant que les prisonniers. De fait, le récit patauge dans un rythme redondant où l’ennui devient notre principale préoccupation plutôt que le sort de ces malheureux.
Bref, Captifs se révèle très conventionnel. Exception faite d’une mise en scène léchée et d’une image poisseuse, le film de Yann Gozlan n’invente strictement rien. Il se contente de reprendre la recette du genre sans y apporter une identité propre. L’on pourra déceler un mélange entre Ils et Paradise lost qui ravira peut-être les novices en la matière. En revanche, les personnes qui font une overdose de ce type de productions n’y trouveront qu’une impression de déjà-vu où l’on stagne dans des geôles exiguës où suintent la peur et la crasse. Sympathique à certains moments, Captifs se révèle beaucoup trop classique pour emporter l’adhésion.
Publié le 21 Février 2011
Salt
Evelyn Salt, agent de la CIA, est accusé d’être une taupe au service de la Russie. Contrainte de s’enfuir pour prouver son innocence, elle voit ses anciens collègues la pourchasser. Philip Noyce est un grand réalisateur qui nous a déjà offert d’excellents thrillers tels que Bone collector, Calme blanc ou dernièrement Au nom de la liberté. Il n’est pas un inconnu du film d’espionnage puisqu’il est l’auteur de deux opus de la saga Jack Ryan (Jeux de guerre et Danger immédiat). L’on constate alors qu’il n’en est pas à son coup d’essai et que Salt renoue avec un cinéma nerveux et ô combien efficace.
Nanti d’un casting cinq étoiles avec une Angelina Jolie impitoyable et un Liev Schreiber des plus impliqués, Salt ne laissera que peu de place à la réflexion ou aux enjeux géopolitiques qui découleront d’une chasse à l’homme rythmé et soutenu. On s’interroge alors sur la véracité des accusations qui pèsent sur Salt. Complot à grande échelle ou manipulation isolée ? Grâce à un suspense au cordeau, le réalisateur manipule les faux-semblants en se jouant des points de vue et de la perception que l’on peut avoir de l’intrigue. À tel point que pour nous, pauvre aveugle qui ère parmi cette nébuleuse histoire, on se prend à déceler des incohérences là où l’on trouve une explication simple et astucieuse plus en amont.
Certes, l’ensemble n’invente rien et ne révolutionnera nullement le genre. Toutefois, les nombreuses qualités qui en découlent permettent à cette production survitaminée d’emporter l’adhésion. Une mise en scène irréprochable, des acteurs qui le sont tout autant, sans oublier une action de tous les instants, Salt est un film d’espionnage réussi où l’on n’a pas le temps de s’ennuyer. Si l’on peut le comparer aux modèles du genre, c’est sans doute de Jason Bourne que l’on pourrait rapprocher Salt. Personnage ambigu qui cultive le mystère sur sa véritable nature afin de surprendre son entourage et, par la même, le spectateur.
Rien de bien neuf sous le soleil hollywoodien avec ce Salt. Ne recherchons pas une quelconque innovation, mais contentons-nous d’un savoir-faire très académique qui n’a plus rien à prouver pour user de ficelles aussi éculées qu’efficaces. C’est en cela que le film de Philip Noyce s’en sort. C’est-à-dire par le biais d’un scénario maîtrisé qui n’avance pas à l’aveuglette et qui, selon toute vraisemblance, en surprendra plus d’un lors de son dénouement qui laisse certains aspects de l’histoire entrouverts. Un blockbuster divertissant où le spectacle est assuré.
Publié le 21 Février 2011
Buried
Un homme se réveille dans un cercueil avec un téléphone portable et un briquet. Derrière ce pitch très simple au premier regard, il se cache un concept absolument insensé et audacieux qui fait se dérouler l’intégralité du film dans un cercueil avec un seul et unique acteur pour nous tenir en haleine. Un pari fou ? Impensable ? C’est ce que l’on pourrait croire avant d’avoir vu Buried. En effet, comment parvenir à diversifier une action dans un espace aussi réduit qu’inextricable sans perdre le spectateur dans un ennui profond ? Ce que nous n’aurions jamais osé rêver, Rodrigo Cortes l’a imaginé et mieux, il l’a rendu possible via un métrage étonnant et définitivement unique.
Des cris étouffés, des jambes qui frappent contre du bois. Le réveil de Paul est brutal, le nôtre également puisque l’on va accompagner son calvaire durant les 90 prochaines minutes. L’aspect le plus important du film, auquel il aurait été le plus facile à le perdre, est sans doute la claustrophobie inhérente à ce genre de situation. Faire ressentir l’exiguïté des lieux tout en parvenant en trouvant les angles de caméras adéquats n’est pas une mince affaire, loin de là. Grâce à un jeu habile, le cinéaste s’immisce dans ce cercueil via une fluidité de mise en scène et un éclairage tantôt froid et désespérant (l’écran du téléphone portable), tantôt pesant et âpre (la chaleur du briquet). Par la suite, d’autres teintes viendront ponctuer le récit.
Le film de Rodrigo Cortes s'amuse avec nos nerfs. Formidable suggestion de circonstances innommables qui suscite l’empathie du spectateur. Le réalisateur ajoute à ce climat délétère la tension d’un compte à rebours qui finit de combler nos attentes. Le temps est compté et la situation est au point mort. Les conversations téléphoniques succèdent à une réflexion soutenue pour tenter de déceler la solution qui permettra de mettre fin à cet enfer. Viennent alors moult interrogations pour accompagner un récit qui ne faiblit pas un seul instant. Que se passe-t-il réellement ? Comment sortir d’une situation qui, à première vue, semble désespérée ? Des tortures psychologiques qui nous tiraillent autant que l'unique personnage à l'écran.
Buried est un film atypique, c’est le moins que l’on puisse dire. Nanti d’une réputation qui le précède, cette production originale et d’une indéniable curiosité emporte l’unanimité tant sur le plan esthétique que technique. Pour la petite comparaison, son sentiment d’enfermement égale celui de Haze (Shinya Tsukamoto), moyen métrage asiatique tout aussi fascinant et incroyable que ce Buried. Ingénieux, immersif et terriblement angoissant, Buried fait partie de ces productions indéfinissables, voire des OVNIS qui prouvent qu’avec du talent et de l’imagination, on parvient à faire des films intéressants et inventifs avec peu de moyens. Chapeau bas monsieur Cortes.
Publié le 18 Février 2011
Centurion
En Angleterre, une légion romaine se fait décimer par les pictes. Une dizaine d’hommes survivent au massacre et se retrouvent pourchassés par leurs ennemis à travers les contrées du Hampshire. Le nom de Neil Marshall n’est inconnu pour personne. Après un Dog soldiers qui est passé relativement inaperçus (mais un très bon film), il nous avait offert The descent. Huis clos claustrophobique comme on en a rarement vu au cinéma. Son Doomsday, description post-apocalyptique d’un monde sans avenir possédait également ses qualités, même s’il est loin de faire l’unanimité auprès du public. Cette fois-ci, le réalisateur s’attaque au péplum avec Centurion.
Un film barbare au sens large du terme puisque l’on décèle dès les premiers instants une violence exacerbée où les batailles font preuve d’une haine aussi véhémente que stylisée. Décapitation, démembrement ou énucléation, quel que soit le moyen employé pour tuer, il est montré avec toute l’agressivité et la rage que requiert un tel exercice. Aucun hors champ ne vient rassurer un public frêle et peu enclin à se retourner les boyaux durant les 95 minutes qui vont suivre. Les gerbes de sang fusent, les hommes vocifèrent leur douleur. Le réalisateur s’accapare les champs de bataille pour en faire un tableau brut de la barbarie environnante.
Neil Marshall ne se contente pas d’aligner une violence outrancière en délaissant ses personnages. À travers des paysages absolument somptueux mis en valeur par des plans larges qui le sont tout autant, notre groupe de survivants arpente les forêts d’Angleterre telles de pauvres proies traquées par des chasseurs aguerris. Cet aspect de l’histoire, nous fait indéniablement penser à des productions plus contemporaines comme Délivrance ou Sans retour (surtout si l’on considère le "côté militaire » des choses pour ce dernier). Plus qu’à des péplums classiques (dans le bon sens du terme), Centurion dispose de nombreuses similarités avec des films de Viking tel que Le 13e guerrier ou Pathfinder.
Bref, Centurion démontre si besoin était que Neil Marshall conserve tout son talent au profit d’un rythme soutenu qui ne laisse poindre aucun temps mort. Dotée de teinte froide et marquée, la photographie possède un aspect « nature sauvage » qui magnifie un cadre déjà extraordinaire tant sur ses possibilités d’évolution que dans son esthétique. Beau, violent et d’une incroyable force, Centurion est un film qui ne fait pas dans la dentelle, le genre de productions qui décide d’appuyer les confrontations en servant les deux points de vue de manière à souligner l’incompréhension qui les habitent plutôt que de diaboliser l’un et auréoler l’autre. Une sombre fresque d’une page peu glorieuse de l’Empire romain.
Publié le 18 Février 2011
Evil Angel : L'Ange de Satan
Lilith, un puissant démon, se réincarne dans les corps « inhabités » de jeunes femmes afin d’assouvir sa vengeance sur les humains. Evil angel marque la transposition du mythe biblique de Lilith à notre époque. La plupart du temps, ce genre de procédé se révèle audacieux et inventif. Pour preuve, l’excellent Eternal de Wilhelm Liebenberg où l’histoire de la comtesse Bathory se voulait une adaptation contemporaine de sa légende. Il en ressortait une production immersive et singulière. Ici, c’est une nouvelle femme fatale qui massacre les pauvres pécheurs que nous sommes. Une sorte de succube dont le seul et unique but et de perdurer une cruelle souffrance en ce bas monde.
Tout d’abord, l’histoire met d’emblée le spectateur dans les conditions appropriées pour apprécier pleinement le film qui nous attend. Une introduction sans ambages où le mystère et l’horreur se conjuguent pour créer des débuts on ne peut plus prometteurs. Le reste de l'intrigue ne nous trompera nullement sur la marchandise. Bien au contraire, alors que l’on se croyait à voir un énième DTV sans saveur, l’on se rend compte qu’il n’en est absolument rien. La mise en scène distribue savamment ses cartes sans dévoiler son jeu trop en avance.
Un suspense distillé au compte-gouttes qui permet à l’histoire de suivre son cheminement avec entrain et implication de notre part. Il en ressort des moments forts où les massacres succèdent à une enquête plus posée, mais loin d’être dénués d’intérêts. Là encore, on salue un casting des plus investis qui ne font pas des tonnes pour impressionner ou démystifier leur personnage. Ajoutons à cela des effets spéciaux étonnants et l’on obtient un film surprenant sur bien des points. Certes, le fond demeure assez convenu et prévisible dans l’ensemble, mais tout se joue sur la manière d’aborder le sujet grâce à un entretien permanent du mystère autour de Lilith.
Bref, Evil angel se révèle une production inattendue pour une histoire qui n’est pas moins prenante et maîtrisée. Une réalisation soignée, un scénario peut-être classique dans le fond, mais très bien amené, sans oublier un démon omnipotent (qui n’est pas sans rappeler celui du Témoin du mal de par sa capacité à changer de corps à sa guise), le film de Richard Dutcher mérite d’être découvert compte tenu de ses nombreuses qualités. Il en ressort un moment mi-épouvante mi-horreur qui comblera tant les amateurs de gores à certains moments que les personnes désirant une intrigue intéressante ne se voulant pas qu’un simple prétexte au déferlement de la colère de Lilith. Une excellente surprise en ce mois de février.
Publié le 17 Février 2011
Harpoon
Un groupe de touristes se retrouve confronté à des anciens pêcheurs de baleines qui ne sont pas prêts de raccrocher le harpon. Ils ont seulement décidé de changer de proie. En Islande, il y a les fjords et les baleines, mais ici vous ne verrez ni l’un ni l’autre. Énième survival qui essaye de recomposer une histoire similaire à Délivrance ou Détour mortel, Harpoon prend place sur un baleinier où une famille de psychopathes s’ennuie ferme sur leur navire. Pour se divertir, rien de tel que d’assassiner quelques touristes en mal de sensations fortes. Si le cadre laisse paraître un aperçu d’innovations, il n’en a que l’arrière-goût.
Bien rapidement, on se rend compte que le film véhicule, encore et toujours, la même trame scénaristique sans se départir de personnages tant improbables que caricaturaux. D’ailleurs, les reparties entre les différents intervenants offrent des moments cocasses pour le moins inattendu. De fait, le parti pris de départ pour confronter l’économie exsangue d’une région et les écologistes prônant l’interdiction de la pêche à la baleine pour sauver une espèce en voie d’extinction sombrent dans une maladresse malvenue. La faute à un traitement beaucoup trop léger qui termine de décrédibiliser une histoire de prime abord sérieuse.
En ce qui concerne le reste du scénario, rien que du très classique qui sent irrémédiablement le réchauffé. Même si l’on ne voit poindre aucune forêt impénétrable à l’horizon comme c’est si souvent le cas, l’immensité de l’océan se charge allègrement de faire ressentir l’isolement et la solitude des touristes. Le film peine à démarrer convenablement. Il faut près de 40 minutes pour que le premier meurtre surgisse sans crier gare, laissant le spectateur, ainsi que les protagonistes, dans l’incompréhension totale en tentant de cerner pourquoi les pêcheurs tuent subitement au lieu de les mettre en confiance et de les séparer pour mieux s’en débarrasser.
Bref, Harpoon est un survival banal et perfectible sur bien des points. Malgré un cadre séduisant qui nous change des habituelles forêts et autres coins paumés des États-Unis, la majorité du récit se déroule de nuit et sur un baleinier. On retiendra des personnages trop stéréotypés, à la limite du ridicule qui ne convainc guère pour développer un sujet aussi sensible que celui-là. Il reste quelques effets gores assez saisissants. Un film prévisible du début à la fin qui ne recèle aucune surprise. Pas même un rebondissement de dernière minute.
Publié le 16 Février 2011
Le Beau-Père 3
Jerry Blake s’échappe une fois de plus de l’hôpital psychiatrique après avoir tenté d’assassiner sa famille. Dans une petite ville tranquille, il est bien décidé à trouver le bonheur. Troisième et dernier volet de la saga Stepfather, ce nouvel épisode fut purement destiné à une exploitation télévisée. Après un premier film mémorable et une suite sympathique, mais pas exceptionnelle, Jerry Blake refait à nouveau parler de lui, mais pas de la meilleure des manières qui soit. D’autant plus que les précédents opus avaient suscité, en leur temps, une certaine attente.
Premier constat et non des moindres : le remplacement de Terry O’Quinn par un sombre petit acteur répondant au nom de Robert Wightman. À cause de lui, tout ce qui faisait le charme du personnage et, par la même, celui de la série, s’envole comme par enchantement. Outre la catastrophique comparaison avec son illustre aîné, monsieur Wightman ne possède nullement le charisme que requiert un tel rôle. Le côté ambigu et inquiétant de Jerry passe à la trappe pour donner un psychopathe sans état d’âme des plus classiques. On avait pu constater un léger revirement de situation dans le deuxième volet, mais dans le cas présent, c’est plus que flagrant. Quand bien même l’introduction tente de justifier le changement physique, nous ne sommes pas dupes et la personnalité de Jerry Blake s’est effacée en même temps que son visage.
Malgré cela, on espère avoir droit à une suite qui tient la route sur le plan du scénario. Là encore, cruelle déception. Les scénaristes ne se sont pas cassé la tête, bien au contraire. On reprend trait pour trait l'histoire véhiculée par les autres films pour remettre le couvert une fois de trop. Même les réactions de Jerry paraissent vides de sens pour cet homme qui était attaché aux traditions familiales. Ici, il trompe sa femme, tue sans raison flagrante pour un oui ou pour un non. A ce titre, les assassinats subissent un montage calamiteux ou l’on décèle un temps de latence (dans la plupart des cas) entre le coup porté et l’arme (la pelle ou le râteau) qui frappe sa victime.
Bref, Le beau-père 3 est une suite inutile, bâclée et opportuniste. On lui reprochera une histoire percluse d’invraisemblances, d’un nouvel acteur amorphe et complètement transparent qui singe un personnage pourtant intéressant et complexe. Les meurtres se veulent téléphonés et sombre parfois dans le grand-guignolesque en flirtant avec l’horreur faute de les crédibiliser convenablement. Davantage un nanar de classe moyenne qu’un bon thriller haletant (comme ce fut le cas pour le premier), un troisième volet médiocre dont on ne fera pas étalage par la suite. La preuve, il n’a nullement pas bénéficié d’une sortie DVD en même temps que les deux autres films. C’est dire l’intérêt que l’on porte à celui-ci.
Publié le 14 Février 2011
Le Beau-Père 2
Après avoir tenté d’assassiner sa nouvelle famille, Jerry Blake est interné dans un hôpital psychiatrique d’où il ne tarde pas à s’échapper pour rechercher le foyer parfait qui sera le sien. Après l’excellent film de Joseph Ruben (qui passe le flambeau à Jeff Burr), Jerry Blake est de retour alors qu’on le croyait passer de vie à trépas. Le premier volet décrivait le parcours sanguinaire d’un sociopathe qui ne supportait pas les contradictions de ses proches, sous peine de les tuer pour régler le problème. À travers le personnage, on nous offrait un thriller angoissant et maîtrisé. Le second suit le même chemin. Une séquelle qui s’avère de bon augure, d’autant plus que l’on retrouve Terry O’Quinn dans un rôle qui lui va à ravir.
Si le changement de réalisateur peut laisser sceptique (surtout au vu de sa filmographie), ce deuxième opus reprend principalement une trame narrative identique à son prédécesseur. À savoir, la quête inlassable de Jerry pour trouver un foyer où il pourra s’épanouir. Dans un premier temps, on distingue certaines longueurs çà et là au fil de l’intrigue. L’ensemble se laisse suivre agréablement, mais l’inquiétante présence de Jerry se veut moins angoissante, même si l’interprétation de Terry O’Quinn demeure irréprochable. Il faut reconnaître que, sans lui, un tel projet se serait avérait vain et inutile. Force est de constater qu’une fois de plus, il occupe le devant de la scène et, bien que l’histoire soit sympathique à plus d’un titre, son personnage est clairement l’attrait principal du film.
La folie se révèle moins pernicieuse, pour ne pas dire perverse. La faute à un traitement moins profond, tant sur le plan dramatique que sur la critique de la bienséance américaine. Quartier calme, maison cossue et voisin dévoué, le parfait cliché du rêve américain (si tant est que l’Amérique fasse encore rêver). Certes, Jerry est toujours attaché aux traditions et à un rigorisme à toute épreuve, mais étrangement ses proches n’y voient que du feu tandis que certains soupçons se forgent dans leur entourage. Chose amusante quand l’on sait que la méthode de Joseph Ruben était exactement l’inverse.
Bref, Le beau-père 2 est une suite sympathique. Elle se révèle néanmoins moins âpre que le fabuleux premier opus. On lui reprochera principalement un rythme inégal ainsi qu’un détournement du personnage de Jerry à la limite du caricatural (on pourrait comparer son évolution d’un film à l’autre avec le docteur Feinstone dans Le dentiste, en moins marqué). En dehors de cela, on peut se laisser prendre dans ces nouvelles péripéties où Jerry recherche désespérément une famille digne de ce nom. Un thriller plus conventionnel dans le sens large du thème, mais tout de même distrayant.
Publié le 14 Février 2011
Le Beau-Père
Après avoir assassiné sa famille, Jerry Blake change d’identité et se trouve un nouveau foyer où s’épanouir. Seulement, la jeune Stephanie émet des soupçons sur sa personne. Elle se rend compte qu’il n’est pas le mari idéal qu’il veut bien laisser paraître à son entourage. Et si le véritable visage de Jerry faisait surface ? Joseph Ruben est un cinéaste qui se fait discret. En trente ans de carrière, il n’a réalisé qu’une grosse douzaine de films. Le dernier en date étant Mémoire effacée (2004). Aussi, Le beau-père est un thriller très connu de la fin des années 1980 en s’inspirant d’un fait réel. Une histoire sordide qui sera, à n’en pas douter, une amorce à deux autres de ces films : Le bon fils et Les nuits avec mon ennemi où il développera plus en amont ses prédilections pour la noirceur de l’âme humaine.
On dénote de sa part un savoir-faire certain pour instaurer une atmosphère poisseuse qui happe le spectateur dès les premiers instants en reconstituant la scène de meurtre de la famille de Jerry. D’emblée, on se rend compte de sa personnalité instable, pour ne pas dire névrotique. Être impitoyable, psychopathe ou perfectionniste extrême, on tente de le cerner sans y parvenir pleinement. On ressent cette aura malsaine qui émane de lui comme le fait si bien remarquer la jeune Stephanie. Il faut reconnaître que ce travail de fond se serait avéré vain sans la prestation inquiétante et irréprochable de Terry O’Quinn. Acteur au sommet de son art qui capte l’essence même de son personnage pour le magnifier à l’écran via une gestuelle et des mimiques des plus crédibles pour un tel rôle.
Mais le beau-père n’est pas de ces films qui racontent une histoire pour le simple fait d’exposer une violence injustifiée et encore moins gratuite. Le récit s’appesantit sur les valeurs morales d’une Amérique conservatrice où les traditions prévalent sur un quotidien parfois aux antipodes avec ces préceptes. Sans trouver une justification aux meurtres de Jerry, il se veut le garant d’un mode de vie rigoriste. On peut également y déceler de sa part une insatisfaction permanente par rapport au fruit de son travail et à son entourage. Tout se joue sur le ressenti, les regards entre les protagonistes, la tension palpable de l’instant. Chaque élément mis en œuvre apporte le trouble au profit d’une intrigue solide et prenante.
Bref, Le beau-père est un thriller des plus fascinants. Outre un travail de fond exemplaire au niveau de la réalisation et de la caractérisation des personnages, le film de Joseph Ruben parvient à distiller un climat tendu via des rapports conflictuels entre les différents intervenants. Le beau-père est également l’occasion de découvrir Jerry Blake, inquiétant individu en quête d’une perpétuelle et inaccessible perfection. Une prestation hors du commun pour un thriller efficace qui, de par une histoire non dénuée de réflexion, nous happe dans son sillage.
Publié le 14 Février 2011
Mirrors 2
Dans un centre commercial, un veilleur de nuit est victime d’hallucinations qui mettent en scène ses collègues en train de s’automutiler. Le lendemain, il se rend compte que ses visions sont réelles. Les personnes concernées meurent dans des circonstances similaires. Suite du film d’Alexandre Aja qui était également le remake d’un film coréen, Mirrors 2 reprend la même trame scénaristique que son prédécesseur en changeant simplement le casting. Un procédé que l’on a déjà pu observer auparavant dans 8 mm ou L’effet papillon. En général, cela nous a donné de pitoyables séquelles sans grand intérêt. Qu’en est-il de ce Mirrors 2 ?
Malgré l’absence d’Alexandre Aja (comme ce fut le cas pour la séquelle de La colline a des yeux), l’histoire démarre sur de bonnes bases. Un scénario presque identique, mais toujours intéressant à suivre ; des acteurs peu connus, mais suffisamment convaincants pour nous entraîner dans les méandres du centre commercial. Autant d’éléments qui jouent en sa faveur. À cela, on peut ajouter des scènes gores qui ne lésinent pas sur l’hémoglobine et les « accidents » malencontreux pour illustrer des séquences violentes et parfaitement dans le ton du film. L’épouvante n’est pas au rendez-vous, mais l’on se plaît à contempler un cadre poisseux et froid.
Toutefois, on pourra noter quelques légères baisses de rythme entre deux visions. À ce moment, le scénario laisse paraître ses faiblesses. La faute à une intrigue similaire à l'oeuvre originale. Pour combler ces quelques écueils, le cinéaste aurait pu jouer sur l’aspect psychologique du reflet qui martyrise son double ou inversement. Le film coréen était parvenu à cette tension presque palpable où l’on s’interrogeait véritablement sur les réelles implications d’une histoire riche qui méritait une réflexion sur la symbolique du miroir. Or, le principal défaut de Mirrors 2 serait alors d’être le troisième volet de la saga puisque le concept s’est édulcoré au fil du temps.
Bref, cette suite n’est pas la catastrophe annoncée. Le film dispose d’une réalisation soignée et d’acteurs sobres pour donner vie à une production certes classique dans le fond, mais suffisamment efficace pour tenir en haleine le spectateur. Malgré des défauts plus qu’évidents, le cinéaste s’en sort globalement bien. Bien que l’idée de départ s’émousse au bout de trois films, on se prend rapidement au jeu. Un DTV loin d’être irréprochable, mais également loin d’être un navet innommable. Bon sans être incroyable.
Publié le 10 Février 2011
Pages |
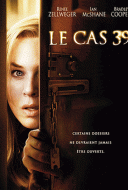

















![La Nuit de la comète [Édition Collector Blu-Ray + DVD + Livret] La Nuit de la comète [Édition Collector Blu-Ray + DVD + Livret]](https://www.horreur.net/sites/default/files/styles/vertical-grand/public/upload/nuitcomete_bd_rimini.jpg?itok=cfnFyIUX)