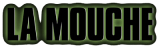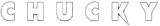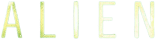Critiques spectateurs de Dante_1984
Pages |
Scott Pilgrim
Scott Pilgrim, ado en mal d’amour, rencontre Ramona la fille « idéale ». Alors qu’il rêve de produire son premier album de musique, il doit affronter ces 7 ex pour avoir le droit de sortir avec elle. Après les inoubliables facéties du duo Martin Freeman / Simon Pegg dans Shaun of the dead et Hot fuzz, Edgar Wright décide d’adapter la bande dessinée de Bryan Lee O’Malley dont je ne suis absolument pas familier. Un choix saugrenu pour le cinéaste qui, en l’espace de seulement deux films, est parvenu à susciter moult attentes pour ses projets. Si l’enrobage technique s’avère des plus soignés, le reste ne suit malheureusement pas.
Derrière tout ce fatras visuel où l’on dénote une influence clairement axée sur l’univers des comics et des jeux vidéo assez aguicheuses, se cache une histoire des plus conventionnelles. L’on se dit que le design du film fait penser à un écran de fumée destiné à masquer les carences d’un scénario vide et peu entraînant. Le récit ressemble à un mix de fantasy croisé avec un teen-movie de bas étage. Entre les pérégrinations amoureuses d’un looser au charisme proche du néant (insipide Michael Cera) et des combats alambiqués qui surgissent à l’écran comme un cheveu sur la soupe, l'histoire manque de vigueur et de cohérences dans son déroulement. Tout comme les spectateurs du premier combat, l’on pense « Mais c’est quoi ça ? »
Je suis bien conscient que le design offre un charme tout particulier si l’on y adhère. Vraisemblablement, il m’a laissé de marbre. La faute principalement à son récit, mais également à un casting amorphe. Les jeunes acteurs manquent d’aplomb et surjouent dans des rôles stéréotypés. L’hystérique accroc à Scott, la mystérieuse aux cheveux colorés, le fidèle ami homo ou la sœur mêle-tout, on n’échappe à rien de tout ce qu’à pu engendrer les pires teen-movie qui soit. Ajoutons à cela des chorégraphies de combats qui sentent le réchauffé (le jeu de pied du premier ex-maléfique est un copier-coller de celui du grand méchant dans Combats de maître 2) et l’on obtient un produit où l’apparence prévaut sur le fond. Dernière remarque, les ennemis qui se transforment en pièce sont directement pompés de l’excellent No more heroes sur Wii. Encore une fois, Scott Pilgrim n’a rien inventé.
Bref, Scott Pilgrim Vs the world n’est ni plus ni moins qu’un blockbuster creux. L’influence de la bande dessinée et des jeux vidéo (trame décomposée comme les niveaux d’un jeu) parviennent à créer un univers graphique assez insolite, mais difficilement immersif compte tenu d’un parti pris trop tranché. Une histoire sans intérêt, des répliques sans saveur, un déroulement cahoteux, sans oublier des acteurs on ne peut plus fades (exception faite de Kieran Culkin), Scott Pilgrim ne compte que sur l’apparence, sans se soucier d’une quelconque originalité dans son scénario, si tant est que l'on approfondit l'analyse. Et ce n’est pas des guest-stars comme Thomas Jane ou Clifton Collins Jr qui y changeront quoi que se soit. Un film minimaliste sur bon nombre d’aspects.
Publié le 9 Février 2011
Supercroc
Un crocodile géant sème la terreur au sein de l’armée à travers la Californie. Vous attendiez un pitch davantage élaboré ? Une histoire plus palpitante ? Et bien, il faudra vous contenter de cela puisque nous sommes en présence d’un « nouveau » navet signé Asylum. Les films de la fameuse firme son assimilables à l’alcool ou autre substance plus ou moins légale. Ils sont à consommer avec modération sous peine de faire une overdose de conneries qui ferait passer n’importe quelle gueule de bois pour un lendemain radieux. Des recherches élaborées par d’éminents spécialistes en la matière prouvent que trop d’Asylum nuit gravement à la santé et peut mettre vos fonctions vitales à rude épreuve. Quelques symptômes des plus ragoûtants ont pu être observés à travers le monde : cervelle liquéfiée qui suinte des orifices, abrutissement général ou partiel du pauvre quidam ou même une légère tendance à la schizophrénie.
Plus sérieusement, Supercroc se veut le genre de productions qui multiplie avec une célérité effarante les outrages au bon goût. On commence par le plat principal avec une immonde purée de pixels que l’on ose nommer crocodile. On ne voit l’animal que très rarement dans son entièreté (sauf quand il ravage un quartier paumé de Los Angeles). La plupart du temps, on nous inflige un dos qui comporte plus de pixels que d’écailles, une grosse tête verte avec des yeux tout aussi inexpressifs, un cri et un petit amuse-bouche pour la route. On passe à la suite des réjouissances via un récit sans intérêt qui nous transporte soit dans la forêt, soit dans Los Angeles. Toujours est-il que l’on s’ennuie ferme et que l’on a qu’une hâte : arrêter le DVD à tout prix.
Supercroc, c’est un peu le film qui tente de singer vainement des productions plus séduisantes telles que Lake placid ou Rogue. Quand bien même on essayerait de prendre le film de Scott Harper au second degré, il ne parvient à aucun moment à nous faire sourire ou décrocher un petit hochement de tête. Seule la nullité omnipotente d’une bande de bras cassés suppure d’un salmigondis innommable. On notera des lignes de dialogue plates et inintéressantes au possible qui confèrent au non-sens une nouvelle dimension. On ne s’attardera guère sur une réalisation de patachons où la photographie (présence majoritaire de teintes chaudes absolument incompréhensibles et injustifiées) se révèle une véritable catastrophe.
Bref, Supercroc est un pur produit Asylum. Toujours plus ridicule, toujours plus nul. Une horrible petite production des plus absconses. À la limite, on pourrait lui trouver le rôle de précurseur dans l’attaque aérienne animale. Avant le fameux RVNI (Mega shark) ou bien le PVNI (Mega piranhas), la firme nous octroyait l’insigne honneur d’un CVNI. À se demander si les membres d’Asylum n’ont pas vu un de leurs proches mourir en hélicoptère ou en ont la phobie ! Long, bâclé et sans le moindre doute ridicule à tous les niveaux, l’un des plus mauvais films de crocodiliens qu’il m’ait été donné de contempler avec Crocodile fury qui conserve toutefois sa palme haut la main.
Publié le 8 Février 2011
Paranormal Activity 2
Une famille emménage dans leur nouvelle demeure. Rapidement, il pense s’être fait cambrioler, mais il s’avère que la nature de l’intrusion est tout autre. Après le succès retentissant de Paranormal activity premier du nom, il semblait inévitable de voir débarquer sous peu un nouvel opus. Il aura fallu un an pour que l’on nous resserve exactement le même concept sans rien y changer. Tout le monde connaît la méthode du faux documentaire où l’on fait passer vrai des événements fictifs via des caméras amateurs. En général, cela fonctionne plutôt bien, mais pour cette suite on ressent davantage l’appel des billets verts plutôt qu’une volonté de proposer une réelle innovation tout comme un certain Quarantine. Un triste constat que la suite des évènements sera bien incapable de nous donner tort.
L’histoire est en fait une préquelle au premier volet où l’on découvre la famille de Kristi, la sœur de Kathy. En partant de cela, il s’agit davantage d’un prétexte que d’une réelle justification aux interrogations qui auraient pu demeurer en suspens après le dénouement du film d’Oren Peli. Certes le dernier quart d’heure demeure assez efficace, mais l’on peine à conserver les yeux ouverts. Laborieux serait le mot qui définirait par excellence cette suite des plus discutables. Laborieux dans sa démarche, mais surtout dans un rythme lénifiant qui n’enchantera guère les nouveaux venus et encore moins les personnes ayant visionné le premier film.
Si le premier film avait le mérite d’endormir notre vigilance pour mieux nous surprendre (bien qu’il progresse sur le fil du rasoir avec certaines longueurs), Paranormal activity 2 nous endort littéralement. Des plans identiques qui se succèdent inlassablement, des séquences de la vie quotidienne absolument soporifique et inutile, rien n’est fait pour entretenir une éventuelle angoisse ou interloquer le spectateur. Entre deux moments bucoliques, les nuits nous offrent des plans tout aussi statiques et vains. Cette piscine de malheur, la cuisine ou même la chambre du bébé, rien n’est véritablement palpitant. Des ustensiles qui tombent, une porte qui claque, un oiseau suicidaire qui s’écrase contre une vitre ou même l’objet décoratif du landau qui tourne tout seul et puis… on repasse à une autre journée ! Tout cela ne semble décourager aucunement le réalisateur qui persiste et signe via des moments toujours plus inintéressants, toujours plus ennuyeux.
Bref, vous l’aurez remarqué, la surprise n’est plus au rendez-vous et cela se voit à l’écran. Le réalisateur nous inflige un simple copier-coller de la version originale avec de nouveaux acteurs (et d’anciens) pour fructifier un investissement déjà très léger à la base. On lui reprochera, entre autres : un scénario banal à la limite du scandaleux, une trame apathique qui parvient à détacher le spectateur du peu d’intérêt qu’un tel produit suscite, sans oublier des interprètes aussi plats qu’une limande qui ne parviennent nullement à retranscrire une quelconque terreur au vu des évènements qu’ils vivent. Paranormal activity 2 parvient sans conteste à essouffler une série qui, elle, n’est pas prête de s’arrêter en si bon chemin sur le sentier de l’argent facilement gagné à moindre coût, offert si généreusement par les spectateurs. Une suite décevante qui n’apporte strictement rien au genre.
Publié le 4 Février 2011
Primal
Un groupe de naufragés s’échoue sur une île déserte des Antilles. Dans la forêt, ils découvrent le campement d’une base scientifique dont les occupants ont mystérieusement disparu. Une présence rôde alentour et les traque. Primal n’est autre que le remake de The tribe, film sorti en 2009 qui s’est vu aussitôt revisité par un producteur peu satisfait du résultat du premier opus. Pour cela, on pouvait aisément le comprendre. Une production sans grande envergure qui ne dépassait pas le stade de l’anecdotique. Mais quel intérêt d’opéré un remake aussi rapidement au lieu de remanier le film originel ? Sur ce point, Quarantine est allègrement battu en termes de rapidité et d’opportunisme.
Malheureusement pour nous, dans le monde capricieux des producteurs, nouvelle version ne rime pas forcément avec innovation. L’histoire se veut sensiblement la même à quelques détails prêts. On notera au passage que la plupart des défauts de The Tribe ne sont nullement gommés. Au lieu de retravailler le sujet de fond en comble, l’équipe s’est contenter de reprendre les mêmes aspects sans parvenir à lui ajouter une touche exotique et mystérieuse. Voilà qui remet d’autant plus en question la réelle nécessité d’un remake. Malgré un changement de réalisateur, Roel Reiné patauge dans un marécage qui lui est vaguement inconnu. Davantage enclin à réaliser des séries B d’action nerveuse (The marine 2 et le récent Death race 2), le cinéaste aurait dû se contenter de ce registre plutôt que de s’aventurer dans des contrées pour le moins incertaine.
La variété des séquences manque d’aplomb et le rythme tombe rapidement à plat. Une trame narrative saccadée où se concentre la majorité des morts dans un petit quart d’heure, une introduction trop classique et laborieuse, ainsi qu’un dénouement qui s’étire sur plus d’une demi-heure finisse d’achever une histoire peu encline à l’innovation et au divertissement. On notera au passage, le plagiait éhonté d’une scène de Predator dont Primal semble s’inspirer directement à la source en lui donnant également des faux-airs de The descent, sans la peur instinctive et viscérale que dégage ce dernier. Cela reflète un triste manque d’imagination de la part des scénaristes.
Bref, Primal est un remake opportuniste pour le moins inutile. Comme si cela ne suffisait pas, les producteurs ne nous octroient pas un, mais deux mauvais films où les défauts du précédent opus ressurgisse de plus belle dans le cas présent. Un acharnement injustifié qui termine de faire sombrer cette triste franchise sans originalité aucune dans les méandres de la médiocrité. Il restera quelques plans larges de l’île assez beaux, mais bien inutile pour servir l’intrigue. Et ce n’est certainement pas les références à des classiques du genre ou même la furtive participation de Lance Henriksen qui changera la donne. Une tentative vaine.
Publié le 3 Février 2011
Shark in Venice
David, un professeur d’université, se rend à Venise, là où son père a perdu la vie à cause d’un… grand requin blanc. Il se retrouve pourchassé par la mafia lorsqu’il découvre l’emplacement d’un fabuleux trésor. Danny Lerner n’est pas à son coup d’essai en ce qui concerne les films de requins. Il est responsable de l’immonde Shark zone et du très médiocre Raging sharks. Aussi l’on pourrait penser que le réalisateur ait compris sa douleur ou du moins retenu les leçons de ses erreurs passées. Dès les premières secondes, on se rend compte combien il est vain de placer de telles espérances en ce genre de personnes qui, au lieu de se remettre en question, persiste et signe dans leurs pathétiques productions minables.
D’emblée, on sent la paresse d’un réalisateur peu scrupuleux sur le travail rendu, parler de conscience professionnelle serait un affront aux cinéastes consciencieux. Les séquences s’enchaînent avec une rare indifférence sans que rien ne soit fait pour retenir l’attention du spectateur. C’est bien simple, Danny Lerner semble aussi détaché de son « histoire » qu’un squale affamé d’algues pourrissantes. Il n’en a que faire et cela se voit à l’écran. Un constat d’autant plus malheureux que le charme et la singularité de Venise ne soient jamais mis en valeur. Deux ou trois pauvres monuments rapidement expédiés, ainsi que des canaux bigrement déserts sont le lot de cette horreur (au sens propre du terme).
Au niveau du « scénario », on a rarement vu tant d’incongruités et d’ignorances dans un script. Des requins à Venise ? La stupidité n’a décidément aucune limite. À cela, on ajoute une pseudo-chasse au trésor qui explique intégralement en quoi elle consiste (tant la nature dudit trésor que son emplacement) dans les cinq minutes d’explications où l’on voit batailler de pauvres croisés dans un flashback anémique. On rappelle que le but d’une aventure telle que la quête d’un trésor ou autre objet précieux est d’émerveiller et d’entretenir une part de mystères. Là, on se contente d’une morne ballade dans les canaux de Venise. Pour le ménagement du suspense, on repassera.
Avec tout cet amas d’imbécillités, on en oublierait presque nos chers requins qui sont clairement relégués au second plan. Un squale qui fonce tête baissée dans la caméra, des hurlements étouffés dans un gargouillis de bulles et un peu de sirop d’érable finissent d’achever une réalisation vomitive. Comme si cela ne suffisait pas, les hors-champ succèdent à des stock-shots tirés de documentaires animaliers. Il est amusant de constater que la fainéantise poursuit son chemin sans le moindre scrupule puisque la plupart des plans s’avèrent identiques aux précédents et, lorsque des images de synthèse pointent le bout de leurs dents, elles se révèlent aussi furtives qu’abominables.
Inintéressant au possible, Shark in Venice remet même en question sa propre existence. Un requin qui joue les filles de l’air, des « acteurs » au sommet de leur nullité, ainsi qu’une absence totale d’intérêts font de ce film une ignoble farce surgit des profondeurs que l’on aurait préféré ignorer. Dernier détail qui finit de convaincre du dédain du réalisateur pour cette chose : le générique de fin commence par une musique qui se termine subitement sans que rien ne soit fait pour y succéder. Qu’importe puisque la plupart des spectateurs auront déserté l’écran depuis la moitié du film.
Publié le 2 Février 2011
Resident Evil : Afterlife 3D
Alice poursuit sa vendetta contre Umbrella à travers l’Alaska et Los Angeles où l’invasion des zombies ne faiblit pas. Quatrième volet de la saga Resident evil, Afterlife est l’occasion de revoir Paul Anderson à la réalisation après un premier opus réussi et, à ce jour, le meilleur de la franchise et ce n’est certainement pas ce nouveau film qui me contredira, loin s’en faut. On débute par des aspects purement techniques. Monsieur Anderson dispose d’un budget confortable et il ne se prive pas pour nous le faire miroiter. Le rendu visuel se veut léché, mais par trop synthétique via un foisonnement d’images de synthèse que l’on nous dessert n’importe où et n’importe comment.
L’introduction peut à elle seule résumer ce que sera le film par la suite : une catastrophe, mais surtout un beau gâchis. Des ralentis à outrance, une réalisation pédante qui se complaît dans de sempiternels ralentis prétentieux et que dire de la 3D, pur produit mercantile destiné à rameuter les foules qui n’apporte strictement rien à l’intrigue et encore moins à l’immersion. Quant aux chorégraphies des combats, elles manquent de vigueur et d’inventivité. Mis à part des scènes virevoltantes qui se révèlent complètement hors sujet dans le cas présent (nous ne sommes pas dans un film d’action hongkongais), on ne peut que regretter cette inertie à tous les niveaux. L’idée de voir plusieurs Alice combattre retombe aussi vite qu’un soufflet. Des promesses, mais rien d’autre.
Les autres volets s’octroyaient quelques largesses avec l’esprit originel de la franchise. Certes, cela pouvait décontenancer les plus férus amateurs du jeu vidéo, mais l’ensemble passait plutôt bien via des environnements différents à chaque histoire et quelques clins d’œil aux références du genre des plus appréciables. Or, nous ne parlons plus de largesses ici, mais bel et bien d’incohérences et d’un esprit peu regardant sur la caractérisation des personnages. Claire est devenue amnésique pour justifier sa platitude, Wesker toujours aussi apathique (même si l’on a changé d’acteur), Alice, un peu plus humaine, mais égale à elle-même. Le personnage de Chris Redfield ne changera rien à la donne et sa rivalité légendaire avec Wesker passe littéralement à la trappe.
Bref, Afterlife est le plus mauvais épisode de la saga. Autant les scénaristes que la production se sont reposés sur leurs lauriers. Une intrigue bateau qui démontre sans ambages que la saga s’essouffle à un tel point qu’il serait bon d’y mettre un terme. Au vu du final et des chiffres au box-office, une suite serait d’ores et déjà en chantier. Espérons simplement qu’ils se réveillent pour nous offrir un film digne de ce nom. Ironie du sort, l’initiateur de la saga n’est autre que le responsable d’un épisode qui enterre définitivement la série dans la médiocrité et la suffisance. Une cruelle déception qui méprise un univers pourtant riche et fascinant.
Publié le 1 Février 2011
Resident Evil : Extinction
Alors que le monde est contaminé par le Virus-T, Alice poursuit son périple seule tandis que la puissante multinationale Umbrella poursuit ses expériences sur les morts-vivants. Rapidement, Alice va rejoindre un groupe de survivants dont certains d’entre eux sont de vieilles connaissances. Troisième volet de la saga Resident evil, Extinction coupe court à toutes les spéculations quant à son cadre. D'emblée, on découvre un monde post-apocalyptique où les survivants n’ont pour seule compagnie que le désespoir. Les contrées désertiques, omniprésentes dans le film, font immédiatement penser à Mad Max. Une référence assumée qui permet au film de s’affranchir de ses prédécesseurs. Pour rappel, le premier était un huis clos aux teintes froides ; le second, un survival plus classique dans un milieu urbain (la nuit de rigueur).
Grâce à ce cadre, nous partons avec un bon a priori pour la suite des festivités. Après un deuxième volet des plus discutables sur le plan scénaristique, Extinction tend à s’en éloigner en situant l’action cinq années après la contamination. Ainsi, les voyages itinérants sont donc de rigueur dans un monde désolé. À noter, l’absence de Jill Valentine dans cet épisode pour on ne sait trop quelle raison. À la place, on trouve Claire Redfield, sœur de Chris, en tant que responsable d’un convoi de survivants. L’idée est louable, mais l’on aurait aimé plus d’explications sur l’entre-deux où nos personnages se sont séparés. On remarquera également que le docteur Isaacs occupe enfin une place prépondérante dans l’intrigue et l’apparition d’Albert Wesker qui, il faut le reconnaître, manque cruellement de charisme par rapport au personnage du jeu vidéo.
Tout comme le premier volet en son temps, le scénario prend des largesses par rapport à l’univers vidéoludique. La mythologie des adaptations cinématographiques étant en place, l’histoire prend ses aises avec des protagonistes plus soutenus (Alice et Olivera gagnent en consistance) tandis que d’autres peinent à apporter de l’épaisseur à leur personnage. Outre un Jason O’Mara des plus anecdotiques en Wesker, Ali Larter ne fait office que de remplaçante sans relief de Sienna Guillory. Alors que son personnage (Claire Redfield) possède des traits de caractères distincts et intéressants. Tout comme son histoire personnelle qui passe littéralement à la trappe. Ceux qui ne sont pas familiers du jeu vidéo ne peuvent même pas deviner qu’elle a un frère.
Bref, Resident evil Extinction est un volet qui sort des sentiers battus. De par un virage à 180 degrés pour le cadre et une intrigue résolument plus sombre, Russel Mulcahy parvient à instaurer une atmosphère post-apocalyptique du plus bel effet. Davantage structuré sur le plan narratif que le précédent opus, Extinction se veut moins brouillon qu’Apocalypse. Toutefois, on ne peut s’empêcher de gamberger sur quelques détails (la caractérisation des personnages principalement) assez gênants pour le fin connaisseur. C’est à cause de cela qu’Extinction ne parvient pas à être le meilleur épisode de la saga. Dans le cas contraire, nous aurions eu droit à un troisième volet des plus jouissifs. Il demeure tout de même une belle transposition d’un monde envahi par nos chers amis zombies.
Publié le 1 Février 2011
Resident Evil : Apocalypse
Deuxième volet de la saga Resident evil, Apocalypse débute là où le film de Paul Anderson s’était arrêté. Le virus s’est propagé hors du Hive et a envahi Raccoon City. À présent, les rues de la ville se jonchent de cadavres ambulants et d’expériences génétiques encore plus dangereuses. Dire que cette suite se veut dans la parfaite continuité de son prédécesseur pourrait induire en erreur sur ce qu’elle est réellement. En effet, là où Paul Anderson choisissait de ne pas suivre l’intrigue du jeu vidéo, Apocalypse tend à reprendre un chemin plus classique tant au niveau de la trame de l’univers originel que sur le fonctionnement très convenu du survival en milieu contaminé par les zombies.
De fait, les personnages du jeu vidéo (Valentine, Olivera…) rejoignent l’unique survivante du premier opus : Alice. De victime « impuissante », cette dernière est passée du postulat d’arme redoutable contre les morts-vivants ; si bien que rien ne semble l’atteindre. Ni les zombies, ni les lickers (qui se voulaient l’ennemi le plus féroce dans la précédente histoire). Non, cette fois-ci, il lui faut un ennemi à la hauteur de ses nouvelles capacités. Pour cela, quoi de mieux que le Nemesis, le redoutable ennemi du troisième épisode (en jeu vidéo) qui avait donné maintes sueurs froides aux joueurs les plus aguerris (en difficile, cela va de soit). Pour l’intégrer à l’histoire, une petite pirouette scénaristique qui avait déjà été amorcée dans Resident evil premier du nom afin de fournir un lien entre les multiples ramifications de l’intrigue. À noter que ses proportions ne sont pas du tout respectées. En réalité, il devrait mesurer 2 m 40 et non les deux mètres difficilement atteints.
On regrettera cette trame narrative brinquebalante qui tend à multiplier les points de vue sans jamais maîtriser la direction de la caméra. Un traitement moins brouillon, mais surtout plus appliqué quant au montage final du film aurait permis à Apocalypse d’engranger quelques points supplémentaires. Malgré cela, il faut reconnaître que l’ensemble demeure assez efficace comme le fut en son temps le premier opus. Un constat en demi-teinte qui démontre le potentiel de la saga qui, malheureusement, n’est pas exploité à son maximum, loin s’en faut.
Bref, ce deuxième opus est à la fois à l’image du premier film (rythmé et nerveux), mais également assez différent dans l’ensemble puisque l’on retrouve des personnages issus du jeu vidéo. Si le réalisateur use et abuse des ficelles du genre, c’est pour mieux divertir le public. On ne peut s’empêcher de ressentir un manque cruel de finition sur le scénario. Pas assez élaboré, ni même suffisamment mis en valeur pour combler les attentes du premier volet. Si l’action prend une tout autre mesure (le huis clos cède la place à un terrain de « jeu » plus vaste et éclectique), il demeure tout de même une redondance permanente dans le périple de nos protagonistes. Moins prenant que le film de Paul Anderson, Apocalypse se veut néanmoins distrayant à défaut de s’imposer comme un film de zombies majeurs. L’armée des morts de Zack Snyder étant sortie la même année, la comparaison ne plaide guère en la faveur du film d’Alexander Witt.
Publié le 1 Février 2011
Resident Evil
Un commando est dépêché dans un laboratoire ultra-secret où l’ordinateur central ne répond plus. Sur place, le groupe se rend compte qu’il n’y a aucun survivant, mis à part une jeune femme amnésique du nom d’Alice. La descente aux enfers peut commencer. Adaptation du célèbre jeu vidéo de Capcom que j’ai fait et refait dans tous les sens inimaginables (autant le remake sur gamecube que l’original sur la Playstation première du nom), le film de Paul Anderson n’est pas une transposition fidèle de l’univers de Resident evil. En effet, il apparaît un point important que l’on remarque immédiatement lors de l’introduction : le cinéaste prend une évidente liberté avec des moyens de départ somme tout généreux. Ainsi, pour apprécier ce film (tout comme Wolverine en 2009), il faut être conscient que ce film est une alternative à ce qui nous avait été offert auparavant et non une adaptation pure et dure.
Certes, on peut regretter cette liberté prise, mais il faut reconnaître que l’on se retrouve avec un film nerveux qui propose une trame assez classique dans le fond tout en parvenant à capter notre attention le temps de 90 minutes. Alors, pourquoi s’en priver ? Les premières bases d’une franchise des plus lucratives sont donc posées de manière assez convaincante si l’on excepte certaines souplesses faciles dans le déroulement des évènements. Le personnage d’Alice, empreint de mystères, est en soit la meilleure idée de l’histoire, car il permet d’apporter un autre regard sur les pérégrinations de la société Umbrella. En ce qui concerne, le Hive (littéralement « la ruche »), on se trouve à arpenter un dédale de couloirs étroits, des salles aussi froides que le renvoi une photographie aux teintes aseptisées qui renforce l’aspect urbain et technologique de l’ensemble.
Ainsi, ce Resident evil se concentre à nous fournir un film de genre rythmé qui préfère privilégier l’horreur pure à un traitement plus angoissant. En effet, le côté « horrible » des zombies est plus efficace que la frayeur qu’ils suscitent, pour cela on préférera se tourner vers l’indicible comme Silent Hill sait si bien le faire par le biais d’un brouillard omniscient. Si la plupart du temps cinéma et jeu vidéo ne font pas bon ménage dans un sens comme dans l’autre, le film de Paul Anderson se révèle un amalgame intéressant entre ces deux mondes distincts. L’efficacité du 7e art au service d’une immersion rapide et efficace. L’alchimie n’est peut-être pas parfaite, mais elle se conjugue suffisamment bien pour nous offrir un film distrayant et efficace.
Bref, Resident evil se révèle une adaptation atypique. Il est indéniable qu’il divise les foules. Toujours est-il que si l’on prend la peine d’écarter toute comparaison avec le jeu vidéo éponyme (qui se veut justifiée dans une première approche), on décèle dans le film de Paul Anderson une vision pour le moins inattendue de l’univers si cher à Capcom. La peur est remplacée par l’horreur pure pour conférer au film une atmosphère de série B qui n’est pas sans rappeler moult références cinématographiques. Presque dix années se sont écoulées depuis sa sortie et, chose amusante, on peut constater que le film se veut le précurseur de ce que sera le futur de la franchise vidéoludique (pour rappel, Resident evil 4 changeait clairement le gameplay de la série pour procurer moins de frisson, mais plus de péripéties ; le cinquième volet accentuait encore plus ce virage). C’est-à-dire, clairement orienté vers l’action au grand damne du survival pur. Comme quoi, l’industrie du cinéma s’inspire du jeu vidéo et inversement.
Publié le 1 Février 2011
Expendables - Unité spéciale
Une équipe de mercenaires surentraînés se voit confier pour mission le démantèlement d’un cartel de drogue avec à sa tête un général sud-américain. Le voilà enfin le fameux Expendables signé Stallone. Un film d’action à l’ancienne qui ne fait pas dans le détail, loin de là. On ne s’appesantira pas sur l’histoire qui se révèle être un prétexte au déluge de feu, de fusillades et d’affrontements nerveux que nous promet le réalisateur. Expendables, c’est un peu l’Ocean’s eleven du film d’action : un casting hallucinant que même les plus invétérés n’osaient espérer dans leurs rêves les plus fous. Inutile d’en faire la liste ici, mais l’on se délecte rien qu’à voir le nom de Dolph Lundgren aux côtés de Jet Li ou Jason Statham. Rien que pour cela, le film mérite mille fois le détour. Car avant tout, Expendables est un hommage tonitruant à tout un pan cinématographique des années 1980-1990. Certes, les scénarios n’étaient pas des plus élaborés, mais l’on s’en moquait pas mal étant donné que l’on retrouvait nos acteurs fétiches au rendez-vous. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils nous en donnaient pour notre argent. Cascade, fusillades, jeune femme en détresse et de grands méchants avec des mines patibulaires. Expendables est un peu tout cela à la fois : un condensé de ces années transcendé par une mise en scène nerveuse et immersive. Le mot « divertissement » devient alors un euphémisme face à des péripéties qui jouent la surenchère à chaque instant. Bref, Expendables se révèle à la hauteur de sa réputation ou comment réaliser le film d’action par excellence. Des scènes d’action à ne plus savoir qu’en faire (surtout le final), mais surtout un casting de haute volée font de ce film un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Voilà de quoi faire passer l’immonde remake de l’agence tous risques pour une promenade bucolique dans le bac à sable du jardin public d’en face.
Publié le 28 Janvier 2011
Death Race 2
Incarcéré dans une prison de haute sécurité pour un braquage de banque qui a mal tourné, Carl Lucas est contraint de participer à un jeu télévisé sous le joug d’un odieux chantage. Pour regagner sa liberté, il va devoir gagner cinq courses lors du Death race. Ce second opus n’est autre que la préquelle au film de Paul Anderson. La genèse de l’émission de télé-réalité Death race nous est relatée avec également le passé d’un personnage connu des amateurs du précédent film (que je ne citerai pas pour ne rien spoiler). Un retour aux sources qui a le mérite de soigner son scénario à défaut d’innover. Toutefois durant une heure, aucune course à l’horizon. Si bien que l’on pense s’être fait avoir sur le produit final.
Ne voyons pas en cette suite une œuvre singulière prompt à nous interroger sur les méfaits télévisuels de notre époque (ou à venir), mais plutôt un divertissement qui parvient sans difficulté à remplir son contrat haut la main. A la barre, Roel Reiné qui n’est autre que le responsable du très rythmé The marine 2. De ce côté, on lui fait confiance pour un rythme trépidant qui ne perd pas son temps en vaines facéties. On ne s’ennuie pas un seul instant et l’on dénotera de la part du cinéaste une certaine volonté à ne pas rouler sur les plates-bandes de son prédécesseur. A sa manière, il apporte sa petite touche personnelle par le biais d’une approche pour le moins inattendue. Introduire le film par des combats libres (semblable à l’UFC en plus violent et dangereux) était risqué, mais cela fonctionne plutôt bien.
Fort heureusement, les dernières quarante minutes nous procurent des courses ultra-violente à mi-chemin entre un Mario kart « réaliste » (si tant est que l’on puisse définir Death race comme tel) et Running man pour le style voyeuriste de l’émission de télé-réalité. D’un côté, nous retrouvons donc les fameux bonus d’activation permettant aux pilotes d’attaquer ou de se défendre via les moyens du bord. De l’autre, la grandiloquence et le bagou des émissions télévisées qui parviendraient à décérébrer Stephen Hawking en personne. Design visuel tape-à-l’œil, pin-up gonflée à bloc aux côtés des pilotes, grosse caisse et bien sûr l’équipement qui va avec.
Bref, Death race 2 est une suite des plus réjouissantes. Si l’on retrouve dans sa deuxième partie ce qui a fait le succès (ou l’insuccès auprès de certain) du premier opus, Roel Reiné tend à débuter son récit par le biais d’un travail soigné à défaut d’être innovant. Un pari qui était loin d’être gagné à l’avance mais qui, au final, séduit et emporte l’adhésion du spectateur. On se délectera tant des combats entre prisonniers que des joutes de métal entre carrosseries. Une très bonne distraction en perspective sans prise de tête.
Publié le 27 Janvier 2011
Piranha 3D
Dans une paisible station balnéaire, le spring break bat son plein. Des milliers de jeunes s’y rendent pour faire la fête. Toutefois, les festivités vont tourner court lorsque qu’un ban de piranhas préhistoriques affamés décide de s’incruster parmi eux. Présenté comme le remake de Joe Dante, cette version 2010 ne conservera que la petite bestiole aux dents de rasoir pour asseoir une histoire des plus classiques, mais ô combien distrayante lorsque l’on regarde le film au deuxième degré, voire au troisième. En effet, Piranha 3D préfère jouer la carte du cinéma d’exploitation pure, plutôt que d’opter pour un traitement plus sobre ou, à fortiori, plus sérieux.
Alexandre Aja décide donc de véhiculer les stéréotypes du survival animalier pour notre plus grand plaisir. Des protagonistes sans grandes épaisseurs, mais des plus enjoués compte tenu de ce qui les attend. D’ailleurs, l’accroche de l’affiche « Sea, sex and blood » résume à elle seule ce que vous offrira le film. Des naïades qui se trémoussent sur fond de musique techno, des jeunes survoltés, un producteur de film porno complètement à l’ouest, tout est réunit pour offrir au spectateur un banquet digne de ce nom. Le déroulement est assez classique, mais lorsque les piranhas passent à l’attaque, on nous octroie un festival d’hémoglobines, de démembrements et de curages d’os sans nul autre pareil.
Direct et sans ambages, les petits poissons ne font pas dans le détail. L’attaque de la plage est à ce titre un moment d’anthologie où les victimes s’amoncellent dans des eaux écarlates. Une véritable débandade qui voit son lot de morts toutes plus horribles les unes que les autres et ce n’est pas forcément les piranhas qui en sont toujours responsables. Les clins d’œil aux références du genre (le film original bien entendu, mais surtout Les dents de la mer) fusent à tout vent et s’avère des plus jouissifs. On retiendra la participation de Richard Dreyfuss qui nous offre une introduction des plus sympathiques.
Bref, Piranha 3D est un survival animalier dans la plus grande tradition du genre. Les moyens, plutôt conséquents pour ce genre de production, nous offre une véritable orgie de gore et de tripailles à la volée sans jamais se soucier d’un quelconque réalisme. Qu’importe, étant donné que le plaisir est au rendez-vous et qu’il est de bon ton de prendre tout cela à la légère. Foncièrement classique dans le fond, il demeure un film des plus distrayants où les vacances se transforment en véritable cauchemar. Décomplexé, Piranha 3D se révèle une distraction certaine.
Publié le 21 Janvier 2011
Inception
Spécialisé dans l’espionnage industriel à l’aide de l’extraction des rêves, Don Cobb se voit confier une mission à haut risque qui pourrait être la dernière. Il monte son équipe et prépare un plan que personne n’a jamais osé imaginer : un rêve à trois niveaux. Entre deux épisodes de la saga Batman, Christopher Nolan nous offre des projets tout aussi ambitieux et grandiloquents. Après Le prestige, sombre fresque de la magie au 19e siècle, et en attendant le troisième épisode de Batman, nous voici dans un avenir proche où les rêves n’ont plus de frontières, plus de limites à l’imaginaire, mais également plus aucun secret pour l’espionnage industriel.
N’y allons pas par quatre chemins, le scénario d’Inception est certainement le plus inventif, le plus fascinant et le plus immersif qu’il nous ait été de contempler depuis une bonne décennie. Une idée simple (l’exploration des rêves) qui offre des ramifications infinies pour donner vie à un blockbuster absolument impeccable en tout point. Qu’est-ce que la réalité ? Les rêves sont-ils l’éveil d’un niveau de conscience supérieur ? La frontière entre l’illusion et le tangible s’avère des plus ténues. Du début à la fin, Inception intrigue, ensorcèle. Une plongée dans un monde où l’on peut se croire l’égal d’un Dieu. Architecture rocambolesque, possibilités sans frontière, mais encore les moments d’apesanteur confère au film une patte esthétique somptueuse.
Beau, Inception l’est à n’en pas douter. Immersif, sans l’ombre d’un doute. Mais ce qui parfait la réussite de ce film se trouve dans sa propension à amalgamer le réel et le rêve. Où commence l’un quand l’autre s’efface dans les limbes de la conscience ? Métaphore introspective de ce que recèle l’âme humaine, Inception est un condensé d’émotion pure où se côtoie le variable et l’inconstant dans un maelstrom de tourments tous plus vindicatifs les uns que les autres. Un miroir à plusieurs facettes qui nous entraînent jusqu’au point de non-retour, là où tout semble puiser son origine. Est-il besoin de dire que la musique d’Hans Zimmer nous hypnotise et nous entraîne dans des envolées lyriques ? Un travail hors-pair pour une odyssée sans commune mesure.
Le nouveau Christopher Nolan est un chef d’œuvre du septième art. Outre la claque visuelle qui confère au film une patte esthétique alambiquée et singulière, on demeure extatique face à tant de possibilités, face à tant de maîtrise technique et narrative. Si certains aspects demeurent volontairement sibyllins, c’est pour mieux laisser au spectateur une libre interprétation de ce qu’il a sous les yeux. Parfois indéfinissable tant sa portée émotionnelle s’avère puissante, Inception laisse le spectateur libre de ses mouvements. Il peut s’accaparer cet univers qui, en fin de compte, est un peu le sien. Un blockbuster intelligent qui nous offre une plongée aux confins d’un monde dont on ne ressort pas indemne. Un chef d’œuvre.
Publié le 20 Janvier 2011
Le Secret de la Montagne Bleue
La jeune Bleuette part en quête d’un remède pour sauver son père, le roi des gnomes bleu, dans le monde des humains. Mais elle doit revenir avant la fin de l’heure magique sous peine de disparaître. Roar Uthaug nous avait offert Cold prey il y a déjà quelques temps, formidable slasher dans la plus pure tradition du genre. Cinq années plus tard, il co-réalise avec Katarina Launing un film de fantasy axé sur l’imaginaire. Un changement de registre on ne peut plus radical qui en décontenancera plus d’un. Compte tenu de l’histoire, Le secret de la montagne bleue s’adresse avant tout à un jeune public. Point de violence, ni de monstres vindicatifs à l’horizon puisqu’il s’agit simplement d’une quête pour contrer la maladie du roi des gnomes bleu. Passé une certaine tranche d’âge, on ne peut s’empêcher de songer que les propos rapportés et la candeur ambiante ne dissimulent que niaiseries et complaisances. D’un certain point de vue, c’est exact, mais l’on découvre derrière cette naïveté touchante une histoire sans fioritures qui se contentent d’entretenir des valeurs aussi indispensables que désuètes dans notre société : l’altruisme, le respect d’autrui et de la nature, sans oublier la tolérance. Vous conviendrez que chacun de ces aspects, qui semblent couler de source dans le simple fait d’y penser, ne sont plus que des spectres nébuleux dans une société privilégiant l’individualisme, l’égocentrisme et le paraître. En cela, le film de Roar Uthaug a le mérite de nous ramener à la contemplation de choses plus simples et moins futiles. Apprécier l’instant présent pour ce qu’il représente et non entrevoir une avidité démesurée. Regarder d’abord ce que l’on possède avant de s’apitoyer sur ce qu’il nous manque. Bref, Le secret de la montagne bleue ravira les plus petits par le biais d’un récit magique où il n’est besoin de nulle violence ou d’action pour passer un bon moment. Les plus âgés s’amuseront à disséquer un univers assez limité dans l’environnement, mais porteur de messages plus significatifs dans une analyse un peu plus approfondie. Une petite production discrète qui fait son bonhomme de chemin.
Publié le 20 Janvier 2011
Woochi: Le magicien des temps modernes
Au XVIe siècle, Woochi, un sorcier, est emprisonné par des dieux dans un parchemin pour un crime qu’il n’a pas commis. 500 ans plus tard, ces mêmes dieux le libèrent pour s’occuper de gobelins qui menacent l’équilibre de notre monde. Considéré comme le plus gros succès au box-office coréen, Woochi se veut une production à l’humour décalée où la fantasy et l’action se conjugue pour nous donner un divertissement de premier ordre. Dès les premières minutes, l’histoire nous emporte dans de virevoltants affrontements et une mythologie que l’on devine riche et dense. Parfois un peu trop succinct en explications, puisque les débuts sont assez houleux. En effet, il ne faut pas lâcher une bribe de phrases de la narratrice ou des dialogues entre les personnages sous peine d’être complètement largué par la suite.
Sorcier, rite taôiste et psalmodie incantatoire font partie intégrante d’un univers de magie qui ne se prend pas une minute au sérieux. L’humour est omniprésent et occupe une majeure partie du film. D’emblée l’on se rend compte que le film s’adresse au plus grand nombre par le biais d’une histoire à la fois prenante et somme toute complexe dans ses ramifications. Woochi nous est présenté comme une canaille. Une sorte de Robin des bois asiatique à la démarche nonchalante. Un caractère singulier qui se compose d’une pointe d’arrogance et d’une indéniable insolence tant dans sa gestuelle que dans son comportement à l’égard des autres personnages. Les « dieux » se veulent également incongrue. Pataud et maladroit, il revêt davantage l’aspect d’esprits errants que des divinités toutes puissantes. Les autres personnages secondaires se révèlent assez classiques, mais bienvenues dans l’intrigue.
Tout ce joyeux monde prend part dans un récit divisé en deux parties. La première, en 1509. On aperçoit derechef une maîtrise des combats et de décors splendides, bien que la majorité de l’intrigue se déroule la nuit. Plus qu’une introduction de luxe, un passage obligé pour la compréhension de la suite des évènements. La seconde partie se passe de nos jours avec un Woochi dépassé par la grandiloquence de notre civilisation et ses habitudes pour le moins… surprenantes (les jeunes filles qui se trémoussent pour l’ouverture d’un nouveau magasin ou l’absence de roi). L’adaptation est rude, mais il parvient à s’y accoutumer. Le réalisateur tire partie du cadre pour des affrontements toujours planant et empreint de légèreté.
Bref, Woochi est certainement le film coréen de fantasy par excellence. On regrettera simplement qu’il faille être aussi attentif pour ne pas se perdre dans une mythologie foisonnante, mais ô combien intéressante. Drôle, rythmé et sans aucun doute sympathique à de nombreux égards, on se délecte de chaque instant qui nous est offert. Les 136 minutes passent à une allure folle. On comprend mieux pourquoi le film a fait forte impression dans son pays. Une réputation amplement méritée qui ravira aussi bien les novices que les inconditionnels d’un cinéma asiatique efficace et humoristique.
Publié le 18 Janvier 2011
Pages |


















![La Nuit de la comète [Édition Collector Blu-Ray + DVD + Livret] La Nuit de la comète [Édition Collector Blu-Ray + DVD + Livret]](https://www.horreur.net/sites/default/files/styles/vertical-grand/public/upload/nuitcomete_bd_rimini.jpg?itok=cfnFyIUX)