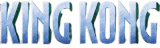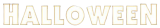Critiques spectateurs de Dante_1984
Pages |
Jonah Hex
Jonah Hex est devenu chasseur de primes après avoir vu sa famille tuée par un renégat. Rongé par la vengeance, il arpente les Etats-Unis sans réel but, jusqu’à ce que le gouvernement face appel à lui pour une mission très spéciale. Adaptation d’un comics dont je ne suis pas familier, Jonah Hex se veut une sorte de melting-pot des genres où se croise pêle-mêle, le fantastique, le western et l’action. A la barre, Jimmy Hayward. Un intrus serait t-on en droit de penser puisque sa précédente réalisation n’est autre qu’Horton. Bien que ce dernier fût une franche réussite dans son style, il apparaît que le choix du réalisateur pour cette histoire sombre à souhait semble être pour le moins incongrue. Toujours est-il que Jonah Hex pose les bases d’un rythme nerveux sans temps mort. On pourra regretter l’aspect « grand public » qui prend le pas sur un style pessimiste et violent. Certes, l’histoire n’est pas non plus un conte de fées, mais les prédispositions du mythe méritaient un traitement plus sombre. Toutefois, on passe un bon moment avec notamment l’impeccable Josh Brolin (pas le héros de La trilogie du mal de Maxime Chattam ;) dans un rôle qui lui va à ravir. Résolument nerveux, le film opte pour un style moderne où la fantaisie des armes se mêle au surréalisme des scènes. En ce qui concerne la patte esthétique, on salue les maquillages, mais également des effets spéciaux convaincants. L’univers en lui-même se révèle assez soigné sur le plan graphique bien qu’une fois encore, on devine un potentiel sous-exploité. En conclusion, Jonah Hex n’est certainement pas exempt de tout reproche. Les inconditionnels du comics seront certainement désappointés. Il demeure tout de même un produit distrayant à de nombreux égards, mais il apparaît également que ce film n’est parvenu à convaincre ni la critique, ni le public. Pour preuve, il fut l’un des plus gros bides de l’année 2010 au box-office mondial.
Publié le 18 Janvier 2011
Ondine
Syracuse trouve dans ses filets une jeune femme. Il la soupçonne d’être une sirène et la recueille chez lui. Auteur de l’excellente adaptation du roman d’Anne Rice (Entretien avec un vampire), Neil Jordan s’essaye à un cinéma plus intimiste. Loin des fastes d’Hollywood et des budgets titanesques, le cinéaste conjugue le fantastique au drame pour une histoire émouvante et prenante dès les premiers instants. Le merveilleux fait irruption dans le quotidien morose d’un pêcheur, alcoolique repenti. Devant la cruelle réalité de sa vie, il se voit inviter à une histoire singulière. Colin Farrell, qui depuis quelques temps multiplie les productions plus discrètes (ce qui est tout à son honneur), campe son personnage avec pudeur. Pour lui donner la réplique, on découvre la troublante Alicja Bachleda. Elle dégage un charisme mystérieux de par sa prestance et sa gestuelle qui finissent d’envelopper le personnage d’Ondine, tout aussi intrigant et insondable. Bien que l’histoire se veuille pour la plupart du temps contemplative, on parvient sans difficulté à s’attacher aux protagonistes. Leurs désillusions et leur vie peuvent facilement s’assimiler aux nôtres. Neil Jordan parvient à nous toucher en incorporant cette touche d’inattendue et de fantaisie dans un monde qui n’a plus rien à offrir si ce n’est un profond désarroi et une fâcheuse attirance pour la bouteille. De fait, la venue d’Ondine apparaît comme une véritable bouffée d’air frais pour tous, tant pour elle que pour les habitants de l’île. Ondine est un conte où le réalisme se révèle le vecteur d’aspirations aussi simples que variées (la guérison d’Annie, la recherche d’une famille…). Bref, le dernier film signé Neil Jordan sort des sentiers battus. Une histoire où l’on se prend à rêver de l’impossible, à se pencher sur notre propre existence. Ondine invite à l’introspection via un récit prenant où l’émerveillement de l’imaginaire se veut un exutoire salvateur pour chacun d’entre nous. Casting excellent, réalisation irréprochable et histoire émouvante font d’Ondine une petite perle que l’on se doit de découvrir.
Publié le 17 Janvier 2011
Oeil pour Oeil
En vacances dans un coin perdu, une romancière est violée par quatre hommes. Elle va exercer une vengeance impitoyable. Film encensé par certains et conspués par d’autres, I spit on your grave n’a laissé personne indifférent en son temps et continue d’entretenir une réputation sulfureuse. Tout comme La dernière maison sur la gauche, le film de Meir Zarchi prend un parti pris radical sur la violence gratuite infligée aux femmes, comme si la nature ranimée en l’homme ses instincts les plus primaires. La première partie s’axe donc sur le calvaire de Jennifer. Aucune ambiance sonore, une mise en scène épurée au possible, le cinéaste ne conserve que la brutalité de l’instant pour mieux la régurgiter tel quel, c’est-à-dire en un acte immonde. La seconde partie, elle, se focalise sur la vengeance. Par la même, la violence change de nature. De gratuite, elle devient justifiée bien qu’elle ne change absolument rien au traumatisme subit. On décèle toujours cette caméra anarchique qui saisit l’instant avec une certaine sauvagerie, voire barbarie. On pourrait crier à l’amateurisme, mais cela renforce la violence qui se déroule sous nos yeux. L’aspect « brut de décoffrage » n’en est que plus renforcée. Malgré une caractérisation des personnages somme toute basique, I spit on your grave ne peut se jauger simplement par le biais d’une technique reprochable. Le cinéaste parvient à tirer parti du cadre avec habileté bien que l’on regrette quelques longueurs qui parsèment le récit. Bref, le film de Meir Zarchi confirme sa réputation sulfureuse. La violence exacerbée prend toute sa dimension dans l’instant. Pris sur le vif, le film a mieux vieillit que La dernière maison sur la gauche. I spit on your grave interpelle, suscite encore bon nombre de débats, mais une chose est certaine : il continuera pendant longtemps à faire parler de lui. A savoir, si le récent remake parviendra à conserver toutes cette verve mis au service d’une sombre histoire de vengeance. Un film d’horreur sans concession qui n’est pas à mettre entre toutes les mains, loin s’en faut.
Publié le 15 Janvier 2011
And Soon the Darkness
Ellie et Stéphanie, deux amies, partent en vacances en Argentine. Sur place, elles tombent dans un petit village et font la connaissance d’un individu pour le moins inquiétant. Après s’être disputée, elles se séparent, mais rapidement Ellie disparaît mystérieusement. Remake d’un film de 1970, And soon the darkness aurait pu s’avérer un film somme toute attrayant compte tenu de son histoire, mais ne nous ne leurrons pas, il ne tient aucune de ses promesses. On ne débattra pas de l’éternelle question si le film originel méritait un remake ou pas, mais l’on peut s’interroger sur la réelle nécessité de faire un énième film sur les enlèvements dans les pays du tiers-monde sans rien y apporter.
L’on débute avec une introduction de deux minutes où l’on aperçoit une jeune femme légèrement vêtu qui subit des électrocutions purement gratuites. A ce stade, on s’attend à un torture-porn assez virulent qui prendra place en Argentine. Seulement, plus le temps passe, plus on a l’impression de s’être fourvoyé sur les intentions de départ. La suite nous conforte dans ce malaise, puisque l’on aura droit à rien d’autre en ce qui concerne cet aspect de l’histoire. Récit qui, au demeurant, reprend grosso-modo une trame extrêmement basique où l’on s’ennuie assez vite.
Pourtant, on tente de s’accrocher et de garder espoir, en vain. Par le biais d’une réalisation sans saveur qui ne prodigue aucune émotion, on parcourt de mornes paysages sans jamais s’émerveiller par la magnificence de la nature ou ressentir la profonde détresse des locaux gangrenés par la pauvreté. Rien n’est entrepris pour nous faire ressentir le calvaire des deux américaines. L’atmosphère est au plus bas quand, tout à cas coup, on retrouve Ellie aux prises avec son kidnappeur. Dès lors, on finit de sombrer dans le plagiat bas de gamme d’autres productions tout en s’appliquant à ne pas froisser les mentalités les plus fragiles.
Bref, And soon the darkness n’a aucun intérêt. Jonchés de longueurs agaçantes, impersonnel, inconsistant et maladroit, on ne ressent aucune envie de la part du réalisateur d’entreprendre le sujet sous un angle différent. On notera tout de même une photographie assez soignée qui se révèle l’un des rares atouts du métrage. Maintes fois vues par le passé, ce genre d’histoires ne peut parvenir à se démarquer qu’avec du talent, de l’audace et une once de lucidité. Or, ici, ce n’est nullement le cas. Un produit lambda pour une histoire tout aussi plate et sans relief.
Publié le 14 Janvier 2011
Tekken
En général, le jeu vidéo et le cinéma ne font pas bon ménage. Dans un sens comme dans l’autre, les adaptations sont le plus souvent de piètre qualité. En ce qui concerne les jeux de baston, on était déjà très bien servi avec un Street fighter ridicule et un Dead or alive des plus inutiles. Avec Tekken, on atteint un nouveau stade de nullité. Je ne critiquerais pas le scénario d’une épaisseur d’une feuille de papier que l’on aurait coupé en deux, cela ne rimerait pas à grand chose. Un jeu de baston vaut pour ses combats et ses personnages pas pour son histoire, au mieux anecdotique.
Dwight Little nous avait déjà octroyé quelques films d’action sympathique (Désigné pour mourir, Rapid fire…). Aussi, l’on se dit que le budget n’est pas en de trop mauvaises mains. Première erreur qui finira de nous achever par un uppercut en pleine mâchoire. Dès les premières minutes, on craint le pire. Un univers futuriste appauvrit à tous les niveaux, des soldats qui lambinent et… Jin Kazama qui effectue son footing du matin (à moins qu’il ne s’agisse du soir). On peut octroyer une certaine marge de liberté à l’histoire étant donné que la trame d’un jeu de baston est quasi-inexistante. Mais là encore, les largesses octroyées se transforment rapidement en foutage-de-gueule éhonté (pardon du vocabulaire, mais il n’y a pas d’autres mots).
Jin habite avec sa mère Jun. Une incohérence par rapport à l’univers vidéoludique, mais pas la pire. On en est qu’à la mise en bouche puisque des personnages tels que Heihashi ne ressemblent à rien sous leur kilo de maquillage. Kazuya – rebaptisé au passage Kayuza – atteint le niveau zéro de charisme et les fans du perso ne peuvent qu’être affligé par la relation avec Heihashi (son père) qui, normalement, se vouent une haine féroce où chaque rencontre finit en affrontement houleux. Ici, tout juste a-t-on droit à quelques joutes oratoires. Mention spéciale à Marshall Law, personnage censé rendre hommage à Bruce Lee, qui se transforme en combattant pataud et mou du bulbe.
En ce qui les combats, rien d’innovant. Les angles de caméra sont passablement calamiteux pour rendre l’action illisible. Mise en scène pédante et indigeste, respect de l’œuvre originale qui sombre dans le néant, esprit du jeu absent. Les défauts ne font que se rallonger pour former un magma informe d’un film qui n’a de titre que le nom. On ne s’entiche guère de l’esprit du jeu ou d’un quelconque souci du spectateur et du fan de la première heure. On se demande encore, comment pareil affront à vu le jour. Un conseil pour l’équipe du film et en particulier les producteurs : terrez-vous dans un bunker, les fans ne vont pardonneront guère cette immondice que vous avez créée sans le moindre scrupule.
Infos de dernières minutes, l’on me signale que l’on a déboursé plusieurs dizaines de millions de dollars pour cette chose. J’aurais voulu attendre au pied du siège de la boîte de production quand ils ont jeté l’argent par les fenêtres...
Publié le 14 Janvier 2011
Les Créatures de l'Ouest
En 1879, un groupe d’hommes se met à la recherche d’une famille disparut. Ils pensent à un enlèvement, mais la vérité est bien plus terrible. Un ennemi invisible les traque sans relâche sans même qu’ils ne s’en rendent compte. Auteur de l’inutile Mimic 3, J.T. Petty s’éloigne quelque peu des ruelles crasseuses des mégalopoles pour remonter le temps et nous plonger au XIXe siècle, en plein cœur du far west. Le mélange Horreur/Western est plutôt rare dans nos contrées. On pense au distrayant quatrième volet de la saga Tremors (mais loin d’être le meilleur ou même le pire), mais surtout à l’incroyable et inégalable Vorace d’Antonia Bird. L’un des films les plus emblématiques et marquants qu’il m’ait été donné de voir. On se tiendra à ses deux exemples, bien qu’il y en ait d’autres à n’en pas douter.
La plupart des critiques que j’ai pu lire çà et là ont tous un point commun : une profonde déception envers le film. En cause : une lenteur indéniable dans son déroulement. Or, The burrowers (on oubliera le titre français) instaure son cadre et ses personnages avec une application rarement vues. Ce soin apporté au travail de fond apporte inévitablement son lot de longueurs ou de séquences plus ou moins discutables. Certes, mais en ce cas l’atmosphère s’en retrouve renforcée et l’apparition des créatures meilleures, du moins à mon humble avis. Comme j’ai pu le signaler dans mon avis sur Linkeroever, il y a deux types deux longueurs : celle qui confère un relief au film et celles qui nous accable pour ne rien apporter. En ce qui concerne The burrowers, nous sommes dans le premier cas.
Bref, The burrowers est un film prenant où l’ambiance du far west allié à des créatures fantastiques fonctionne à merveille (un design très sombre et inspiré qui peut faire songer à The descent). On notera également des têtes d’affiche inconnues qui campent leur rôle avec un aplomb certain. A aucun moment l’horreur ne prend le pas sur le western ou inversement. Le cinéaste jongle entre les deux avec habilité et savoir-faire. Le western horrifique a de beaux jours devant lui. Deux styles très différents, pour ne pas dire aux antipodes, qui parviennent amplement à nous intéresser. Le résultat se révèle immersif et passionnant.
Publié le 13 Janvier 2011
Stonehenge Apocalypse
Stonehenge apocalypse sous ce titre évocateur se cache ni plus ni moins que l’illustre Paul Ziller, responsable des immondes Loch Ness terror, Yeti ou Ba’al pour ne citer que les plus récents. Une belle brochette de navets signés SyFy. Voilà qui n’augure rien de bon pour cette nouvelle production remettant en cause notre existence sur cette planète, rien que cela ! L’aspect catastrophique est passé complètement à la trappe. Un comble pour un film catastrophe.
Budget limité oblige, on nous inflige des effets spéciaux des plus pathétiques. Des pyramides rétractables, un déluge de feu et… plus rien. On revient à l’aventure principale de ces scientifiques au rabais. Le déplacement de Stonehenge est également très mauvais, ainsi que les éclairs censés représenter les champs magnétiques. Pourtant, on était loin d’une catastrophe annoncée au vu du pitch de départ. Certes, on ne criera pas au génie, mais certains éléments méritent d’être remarqués. Notamment, l’explication de la fin d’un cycle et non du monde pour que la vie et, par la même, l’humanité redémarrent sur de meilleures bases. Est-ce un hasard si le film débute sur un article de journal relatant une possible catastrophe en 2012 ?
Toujours est-il que ce seul aspect séduisant est tourné en dérision par le cinéaste, mais aussi par les acteurs. « Non, pas question de mourir. Je préfère vivre dans un monde pourri plutôt que la planète ne se régénère pour aller mieux ! » Bonjour, la compassion et l’empathie des protagonistes ! A vrai dire, d’un point de vue purement altruiste, le « méchant » du film est le seul à ouvrir les yeux sur la nécessité d’une fin de l’humanité pour l’émergence d’un nouveau monde, meilleur on l’espère. Les autres demeurant sur leur position pour prolonger et perpétuer leur pathétique existence ; ce qui rend le final d’autant plus affligeant et ridicule.
Bref, Stonehenge apocalypse n’améliorera certainement pas la réputation de Paul Ziller. Nouvelle incursion dans le domaine des cataclysmes qui pourrait donner lieu à un sous-genre très révélateur de la qualité du produit : la catastrophe éponyme ! Comprenez une catastrophe dans tous les sens du terme. Voilà qui est prometteur pour l’avenir, du moins s’il nous en reste encore un en ce bas monde.
Publié le 13 Janvier 2011
Le Dernier Exorcisme
Le révérend Cotton Marcus se rend dans une ferme isolée de la Louisiane pour exorciser une jeune fille en proie à de graves troubles. Comme bon nombre de ses prédécesseurs, Le dernier exorcisme reprend le thème du faux documentaire que l’on assaisonne d’une bonne dose de surnaturel pour angoisser l’audimat. Le procédé a déjà fait ses preuves avec d’autres productions qui ont fait les lettres de noblesses de ce sous-genre et, à défaut d’innover, ne semble pas vouloir s’arrêter en si bon chemin. A mi-chemin entre Blair Witch et L’exorcisme d’Emily Rose, le film de Daniel Stamm est prompt à instaurer une ambiance assez angoissante. Bien entendu, on ne décèlera aucune réelle nouveauté tant sur le plan de la mise en scène que dans l’histoire. Toutefois, se serait vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué puisque qu’on remarque dans le film d’excellentes qualités qui font de lui, un film à l’atmosphère travaillée. Sans cette immersion, nul doute que le film en lui-même se serait avéré un cuisant échec. Au fur et à mesure de l’intrigue, la sombre fumisterie fomentée par le révérend ne s’avère pas une si grossière arnaque que cela. Au départ quelques indices le laissent penser, puis se sont des moments assez intenses où les crises de la jeune Nell s’intensifient. Habile dans sa manière d’aborder le sujet de l’exorcisme, le réalisateur nous entraîne dans une plongée sombre et audacieuse dans des croyances à la fois païenne et religieuse qui demeure souvent dans l’ombre (du moins, dans la réalité). Pour cela, le cadre de la Louisiane est un terreau fertile à pareil histoire. Quelques fausses pistes ponctuent l’intrigue pour ajouter un peu d’épaisseur, même si on se doute bien qu’il y a autre chose qui se terre sous les apparences. Bref, Le dernier exorcisme ne se révèle pas forcément un long-métrage novateur. Il n’en demeure pas moins, une production maîtrisée qui s’applique à travailler une atmosphère qui monte crescendo jusqu’à un final sans concession et, si l’on se prend au jeu, assez déconcertant il est vrai. Ce n’est pas un modèle du genre, mais une belle réussite à savourer seul dans le noir.
Publié le 12 Janvier 2011
The Restless
Premier film du cinéaste Jo Dong-oh, The restless nous plonge dans l’entre-monde, royaume où les défunts attendent patiemment leur prochaine réincarnation sur Terre. Mais, dans cet endroit pour le moins singulier, un groupe de personnages décimés injustement de leur vivant, décide de renverser l’équilibre des choses pour s’approprier la toute puissance et parvenir dans le monde des vivants avec leur pouvoir. Cette histoire qui se mêle d’une trame romantico-fantastique ne recèlera rien de bien surprenant pour l’habitué des productions asiatiques et, à fortiori, des films de sabres.
Une idylle, des amis devenus ennemis, un monde entre la fantasy et le fantastique, pas de doute, cette production coréenne multiplie tant les influences diverses dont elle s’inspire que les envolées surréalistes de ses protagonistes. La plupart des affrontements se font en semi-apesanteur dans la plus pure tradition du genre. On aime ou pas, mais il faut reconnaître le résultat ne manque pas de panache à l’écran. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de la caractérisation des personnages. Assez plat et convenu, les classiques joutes de départ entre les deux tourtereaux se transforment rapidement en affinités grandissantes. Les méchants ne sont pas en reste puisque seule la vengeance et la haine motivent leurs actions en ce bas-monde (l’autre, pas celui des vivants).
Dès lors, on peut regretter que le récit manque de fantaisie au sens propre du terme. Certes, l’univers reste intrigant et séduisant, mais lorsque l’on creuse quelques peu, on se rend compte que les décors manquent de variété et que la trame scénaristique s’appesantit davantage sur l’amourette qui est au centre de l’intrigue plutôt que sur la sauvegarde de l’entre-monde. De fait, le rythme s’englue dans la niaiserie la plus totale au grand damne du destin de l’entre-monde. Toutefois et malgré un constat en demi-teinte, on peut déceler en ce film de trépignant combats qui ne lésinent pas sur les moyens pour faire preuve de grandiloquence lorsqu’ils daignent débuter. A ce titre, l’idée que le mort succombe ( ?!) en se consumant comme une feuille de papier brûlé étonne, mais convainc. On regrettera qu’ils ne fassent que ponctuer la romance et non l’inverse.
Bref, The restless n’est pas une grande surprise. Scénario convenu, romantisme qui prend le pas sur l’histoire ou un univers qui aurait gagné à être creusé plus à même, les reproches ne manquent pas. Toutefois, le divertissement est assuré, bien que l’émerveillement manque à l’appel. Un film coréen qui s’amuse à mélanger les genres pêle-mêle, sans pour autant parvenir à trouver l’alchimie adéquate. Un essai infructueux. En dépit de ces nombreuses carences, The restless parvient à créer un spectacle virevoltant au gré des vents via un travail de réalisation honnête qui comble quelque peu ses écueils tant sur le plan scénaristique que sur un manque d’idées évident.
Publié le 11 Janvier 2011
Left Bank
La jeune Marie, athlète de haut niveau, est contrainte de cesser son sport à la suite d’une fatigue chronique. Alors qu’elle se repose chez son petit ami, d’étranges évènements semblent la guetter dans le quartier de Linkeroever. Quand un film est volontairement lent, il peut s’en dégager deux impressions bien distinctes. La première est de se retrouver face à un rythme soporifique qui accable le spectateur plus qu’il ne l’enthousiasme. La seconde, nettement plus positive, d’avoir à faire à un cinéaste qui s’applique à instaurer une atmosphère très singulière, voire hypnotique à son œuvre. Autant le dire d’emblée, Left bank fait partie de la première catégorie. Le genre de film qui se révèle prometteur sur le papier – surtout pour un film belge – mais qui, au final, ne se révèle rien de plus qu’une production plate et apathique sur toute sa longueur. Une déception d’autant plus grande que les bonnes critiques concernant le film ne cessent d’inonder les magazines ou le net. Le cinéma de genre belge, à fortiori flamand, est suffisamment rare (pour ne pas dire exceptionnel) dans le paysage cinématographique pour s’y attarder lorsqu’une production sort sur nos écrans. Toutefois, ce ne sera pas avec Left bank que le réalisateur fera parler de lui en bon terme. Si tout n’est pas mauvais dans le film, il en ressort tout de même un sentiment mitigé sur bon nombre d’aspects. Hermétique tant sur ce qu’il tente de véhiculer que sur les moyens employés pour tenter d’instaurer un climat délétère, Left bank se veut davantage proche d’un cinéma d’auteur élitiste plutôt que d’un film de genre plus abordable. L’histoire pose son rythme sur un quotidien maussade et sans grand relief. Ainsi, on ne retiendra que d’incessantes longueurs qui composent principalement le film. Bref, Left bank n’est pas la claque annoncée, loin s’en faut. Mou, sans réel trame pour intéresser son public ou même lui arracher un semblant de curiosité, le film de Pieter Van Hees s’adresse à un public restreint qui se contentera de pérégrinations plutôt fade et insipide à défaut d’être immersive. Une production bancale et sans saveur.
Publié le 11 Janvier 2011
Possession
Remake d’un film coréen, Possession reprend la trame du film original en confrontant une jeune femme à un accident brutal qui métamorphose à jamais sa vie. Histoire intrigante s’il en est, le récit n’est pas, comme le titre pourrait le faire penser, emplit d’esprits et d’évènements surnaturels. En effet, le traitement se veut davantage proche du thriller psychologique que du fantastique. On s’amuse à jouer avec la perception du spectateur tout en laissant poindre un doute calculé sur l’identité de Roman. Est-il réellement devenu Ryan ou n’est-ce qu’une perverse supercherie ? Le principe se veut à la hauteur de nos espérances sur bien des points.
Bien qu’il subsiste quelques errances sur le plan scénaristique, l’ensemble est plutôt bien amené pour que le spectateur s’interroge et ce, jusqu’au dénouement. Entre temps, la vie de Tess est rongée par le doute et le regret. Le remord de n’avoir pris conscience de son bonheur sans nuages. Le reflet d’une vie quasi-idyllique. Mais surtout, le doute de ne pas réellement connaître son beau-frère ou son mari. Car là est l’astuce de Possession : entretenir cette ambivalence entre deux personnages aux antipodes qui, de prime abord, n’ont strictement rien en commun. L’on se dit parfois qu’il est impossible de changer aussi abruptement alors qu’à d’autres moments, on pense que le beau-frère joue la comédie.
Un procédé déstabilisant, maîtrisé, mais qui fonctionne indubitablement. Le cœur même de l’intrigue s’avère donc l’image que l’on donne de nous-même aux autres et notre capacité à la changer, voire à la modeler à notre convenance. Tout cela serait bien vain sans une prestation convaincante de la part du casting. Des acteurs tout en retenue qui parviennent à saisir la personnalité de leur personnage. Mention spéciale à Lee Pace qui, tour à tour, incarne le mauvais garçon par excellence et, ensuite, le mari idéal. Un revirement de situation à l’image du film : troublant.
Bref, Possession en décevra certains de par un rythme volontairement lent pour une approche pragmatique et pudique. Cela aurait pu choquer dans d’autres circonstances, mais compte tenu du thème abordé et de sa volonté à instaurer le doute à chaque instant, on aurait peine à imaginer un autre choix. Au centre d’une intrigue habile et singulière, on décèle un thriller fantastique qui préfère prendre son temps plutôt que de se précipiter vers un sujet qui demande de l’application et du talent. Un choix tout à son honneur.
Publié le 10 Janvier 2011
D4 - Mortal Unit
Un groupe de mercenaires est dépêché dans une forêt pour extraire l’enfant d’une riche milliardaire. Sur place, rien ne se passe comme prévu. Ils sont confrontés à un soldat mutant invincible. Scénario basique pour un film qui l’est tout autant. En effet, D4 n’aura rien de bien intéressant à offrir sous ses airs de série B nerveuse. Enfin, il s’agit seulement de la première impression que nous offre l’histoire puisqu’on va se rendre compte rapidement que pour un mélange Science-Fiction / Action, D4 se révèle bien mollasson pour nous tenir en éveil. Petite randonnée champêtre dans la forêt, exploration de bâtiment désaffectée, rien que du très convenu à l’horizon. Malheureusement, on n’est loin d’en avoir finit avec les nombreux problèmes qui parsèment le métrage. On dénotera une réalisation des plus approximatives avec une mise en scène grossière et sans panache. La photographie, tout ce qu’il a de plus classique, finit de parachever un tableau des plus mitigés. Toutefois, le principal défaut du film se trouve dans une narration bancale qui réussit l’exploit de se mélanger les pinceaux avec une histoire aussi simpliste qu’affligeante (de par certains aspects, elle nous fait songer au jeu vidéo Far cry). On nous inflige des flashbacks inopportuns qui interrompent subitement les séquences déjà peu amènes en rebondissements. Ainsi, les retours en arrière succèdent à un déroulement chaotique qui ne cesse de brinquebaler de toutes parts. Le résultat se révèle des plus indigestes. En conclusion, D4 – Mortal unit est un sous-produit des plus basiques. Soporifiques, maladroits et indéniablement médiocre sur pratiquement tous ses aspects, le film de Darrin Dickerson ne suscitera que consternation face à tant d’amateurisme et de mollesse. Sans aucun doute possible, l’une des premières mauvaises surprises de ce début d’année.
Publié le 10 Janvier 2011
Avatar
Il aura fallu douze ans pour que le nouveau James Cameron débarque sur nos écrans. Après le succès phénoménal de Titanic, le réalisateur récidive de fort belle manière avec Avatar. Tant sur le plan créatif qu’au niveau du box-office, Avatar est une aventure hors-norme. Un monument du septième qui nous happe immédiatement dans un monde fascinant et profond. Pour donner vie à Pandora, deux éléments principaux : un budget colossal et l’imagination intarissable de James Cameron. Dans Avatar, tout est synonyme de démesure au service d’un spectacle qu’il faut vivre pour le comprendre.
Par la même, cette grandiloquence est au service d’un traitement alarmiste quant au devenir incertain de notre planète. Un message écologique à peine dissimuler qui nous fait prendre conscience de la folie de l’homme et son appétit insatiable pour le profit et l’argent. Mais la véritable richesse, emplit de mansuétude et d’humilité, se trouve dans l’harmonie et la relation que l’être vivant possède avec son environnement. Ainsi, on apprend que l’épanouissement personnel passe avant tout par notre capacité à ressentir et éprouver ce qui nous entoure, tant le vivant que l’inerte.
Outre cet aspect écologique traité avec brio, Avatar traite aussi de la thématique de l’étranger. Celui qui ne se reconnaît plus ou celui qui n’est pas de ce monde. Cette approche est une formidable ouverture d’esprit puisque l’on oublie simplement qui est humain ou Na’vi. On dépasse ces considérations sommaires pour s’appesantir sur ce que nous sommes intérieurement. L’important est de sentir honnête envers soi-même et les autres. De fait, l’apprentissage de Jake chez les Na’vi se révèle à la fois une quête d’identité initiatique sur sa véritable personnalité, mais également l’ouverture à une culture et civilisation différente.
Bref, Avatar mérite amplement sa réputation. Volontairement pessimiste sur le plan environnemental, l’histoire démontre avec quelle inconscience la bêtise humaine ne peut se contenter de ce qu’elle possède. Une manière subtile de dénoncer les excès de certain alors que les ressources de notre planète sont loin d’être inépuisables. Non satisfait de créer un monde magnifique et fascinant, James Cameron nous offre une aventure singulière où l’humilité et l’harmonie côtoie la tolérance. Un block-buster bluffant à tous les niveaux. Il faudrait être bien difficile pour ne pas s’émerveiller devant pareil spectacle.
Publié le 7 Janvier 2011
Monstres Contre Aliens
A la suite d’une collision avec une météorite, Susan grandit à une vitesse exponentielle. Elle est rapidement capturée par l’armée et se rend compte qu’elle n’est pas le seul monstre détenu dans ce lieu ultra-secret. Alors qu’un extraterrestre mégalomane tente de conquérir la terre, les cinq monstres sont relâchés pour contrer la menace. Quand on pense au studio Dreamworks en matière d’animation, on songe au plus grand concurrent de Pixar. Alors que les débuts montraient une lutte acharnée entre les deux géants (Fourmiz/1001 Pattes ; Le monde de Nemo/Gang de requins), depuis quelques temps ils semblent s’écarter l’un de l’autre afin de privilégier la création au plagiat à peine dissimulé (d’un côté comme de l’autre).
Après le tonitruant Kung fu Panda et la suite de Madagascar (réussit, mais loin d’être surprenante), Monstres contre aliens arrive comme un vibrant hommage à tout une frange du cinéma de genre. Il serait impossible d’effectuer une liste exhaustive de tous les clins d’œil et autres références ici, mais il ne se passe pas une minute sans qu’on décèle à l’écran un élément de tel ou tel film. Et c’est en cela que Monstres contre aliens s’avèrent un film d’animation des plus réjouissants. Il dispose de deux niveaux de lectures : l’un pour le cinéphile averti qui s’amusera à remarquer les références aux films de monstres et d’invasion extraterrestre ; l’autre pour un public plus jeunes qui n’aura pas le temps de s’ennuyer tellement le rythme se veut soutenu et fluide.
Du côté de l’animation, Dreamworks apporte sa touche personnelle sans pour autant transcender un visuel « cartoon » assumé. Le rendu est beau et s’appuie en grande partie sur la mesure et la démesure des différents intervenants au fil de l’histoire. Tour à tour, on découvre un San Francisco déserté, un vaisseau spatial immense ou même un complexe militaire ultra-secret. Les situations s’enchaînent avec une déconcertante fluidité. C’est bien simple, contrairement à d’autres films d’animation, on ne se dit jamais que le scénario est lésé au profit de l’animation. Inutile de dire que l’ensemble forme un résultat homogène des plus séduisants et qui ne peut laisser indifférent.
En conclusion, Monstres contre aliens est une nouvelle réussite pour les studios Dreamworks. Sans jamais sombrer dans la parodie de bas-étage ou dans le plagiat éhonté de grands classiques, le film de Rob Letterman allie savoir-faire technique à une histoire sympathique et, à aucun moment, redondante. Gorgé de références au cinéma de genre et doté d’un humour qui fait mouche quasiment à chaque instant, ce nouveau film d’animation signé Dreamworks est non seulement réussit sur le plan esthétique, mais il ravira les aficionados de science-fiction et autres films de monstres tout en contentant les plus jeunes dans un divertissement de premier ordre qui ne peut que susciter joie et enthousiasme.
Publié le 4 Janvier 2011
Le Drôle de Noël de Scrooge
A Londres, Ebenezer Scrooge détestent les fêtes de Noël et tout ce qui s’y rapporte. Alors qu’il vit une existence morne et sans relief, il reçoit la visite d’esprits qui vont le confronter à son passé, son présent et son avenir pour le moins incertain. Après Le pôle express et La légende de Beowulf, Robert Zemeckis décide de reprendre les mêmes techniques utilisés auparavant pour cette nouvelle adaptation d’un roman de Charles Dickens. Les images de synthèse sont somptueuses et quasiment irréprochable. Autant dans les décors que les personnages, on ne peut que saluer un travail fouillé et parfaitement maîtrisé. Le jeu des lumières est également bluffant.
On découvre alors, tour à tour, un Londres du XIXe siècle plongeait sous la neige, mais également des jeux de clair-obscur qui ajoute une dimension supplémentaire au travail déjà faramineux. Toutefois, un petit bémol lorsque la caméra se concentre sur la pauvreté des plus démunis. Autant dans les ruelles que dans les taudis, cela paraît un peu trop avenant, voire propret pour parfaire cette atmosphère typique de l’époque. Mais ce ne sont que de menus détails qui n’empêchent en rien de s’immerger dans ce tourbillon complètement fou d’aventures et de drame que propose le film.
Depuis les nombreuses adaptations du classique de Dickens, l’histoire n’a pas pris une ride. Un récit intemporel qui, même si l’époque change, conserve encore de nos jours toutes sa force sur la véritable signification de Noël au-delà des apparences. L’universalité du scénario interpelle et ne peut laisser indifférent surtout en ces périodes où chaque évènement (les fêtes, mais aussi les commémorations d’anciens conflits) se révèle dénaturé ou qui laisse de marbre. Mis à part le chiffre d’affaires explosifs des grandes enseignes, qui est capable d’exprimer ce que représente réellement Noël, tant sur un plan personnel que collectif ? C’est en cela que le personnage de Scrooge continue à perdurer. Personnage aigri et morose qui ne parvient pas à accepter son passé et privilégie un confort personnel bien fade plutôt qu’une chaleur humaine plus réconfortante. Inutile de préciser que la performance de Jim Carrey est hors-norme.
Bref, Le drôle de Noël de Scrooge est un film d’animation de circonstance en ces périodes de fêtes. Même si le film vise un public plutôt large, les plus âgés y décèleront une noirceur insoupçonnée qui nous confronte à nos actes et les conséquences qui en découlent. Rythmé, prenant et d’une indéniable beauté, le dernier Robert Zemeckis se révèle une aventure immersive teintée d’espoir et de rédemption.
Publié le 3 Janvier 2011
Pages |

















![La Nuit de la comète [Édition Collector Blu-Ray + DVD + Livret] La Nuit de la comète [Édition Collector Blu-Ray + DVD + Livret]](https://www.horreur.net/sites/default/files/styles/vertical-grand/public/upload/nuitcomete_bd_rimini.jpg?itok=cfnFyIUX)