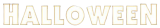Critiques spectateurs de Dante_1984
Pages |
Devil
Après un remake de Rec aussi honteux qu’inutile, John Dowdle se voit confier la réalisation du premier volet des Night Chronicles. Dans ce Devil, cinq personnes se retrouvent coincées dans un ascenseur. Parmi eux, l’une d’elles est le diable en personne. Parfois, les idées les plus simples sont aussi les meilleures si elles sont correctement employées. Or, ce huis-clos qui tend à monter en intensité au fur et à mesure que les cadavres s’accumulent parvient à entretenir le suspense comme il se doit. D’emblée, on essaye de découvrir le coupable. Alors qu’on pense le découvrir, il se fait trucider à son tour. On reporte son choix, puis l’on se rend compte que l’on se trompe encore. Le cinéaste joue avec les nerfs des protagonistes et, accessoirement, avec les nôtres. Ainsi, l’on se rend compte que tout semble savamment travaillé pour promener nos méninges aux quatre coins de cet ascenseur. Les faux-semblants se multiplient, les doutes subsistent. On ne peut s’empêcher de penser à des films tels que l’ascenseur de par le cadre, mais si dans ce dernier l’ascenseur est un tueur doué d’une intelligence artificielle, ici il ne revêt que les apparats du purgatoire de ces âmes damnées en devenir. Aussi, c’est toute la psychologie entre les personnages qui entrent en jeu et qui, par la même, engendre cette paranoïa presque palpable. Avec une réalisation sobre et une photographie qui renvoie la froideur du milieu urbain, Devil surprend là où on ne l’attendait que très peu étant donné que le nom de Shyamalan fait moins rêver qu’auparavant. Le premier volet des Night chronicles laisse augurer le meilleur pour la suite. Une tension permanente, un jeu constant pour dénicher le coupable et des têtes d’affiche suffisamment convaincante pour nous laisser emporter dans l’histoire. Voilà donc un film fantastique maîtrisé qui tend davantage vers la psychologie humaine – notamment notre capacité à pardonner et expier nos péchés – plutôt que vers le surnaturel qui ne laisse planer qu’une ombre fugace au-dessus de l’histoire.
Publié le 31 Décembre 2010
Insane
Un couple se perd dans des contrées isolées où trois psychopathes cultivent de l’herbe. Bien décidé à ne pas laisser échapper leur florissante affaire, ils vont les séquestrer en attendant de savoir ce qu’ils pourront en faire. Il aura fallu six ans à Jamie Blanks pour revenir derrière la caméra. Après le mémorable premier volet de la trilogie Urban legend et un Mortelle Saint-Valentin efficace à défaut d’être original, le cinéaste nous revient avec Insane, film d’horreur très traditionnel. En effet, l’histoire est une fois de plus sans originalité aucune. On additionne couple en détresse, ferme isolée et psychopathes décérébrés pour obtenir l’équation tellement éprouvée d’une situation explosive et hautement périlleuse pour les malheureuses victimes. Bien que l’ambiance demeure soignée via un travail particulièrement soigné sur le cadre putride et glauque de la ferme, l’histoire s’attarde beaucoup trop sur les petites piques gratuites que se permettent Brett et Jimmy. On laisse trop longtemps planer le doute sur leurs intentions aux yeux des protagonistes puisque, pour le spectateur, il ne fait aucun doute de la suite des évènements. Aussi l’on s’impatiente jusqu’à un possible retournement de situation qui tend à se faire désirer. Les vingt dernières minutes montent crescendo en intensité via des séquences assez improbables, mais recherché sur le plan de la mise à mort. Je ne me permettrais aucune divulgation étant donné qu’il s’agit de l’un des rares attraits du film. Ajoutons à cela, une bande son des plus surprenantes qui se révèle le véritable point fort du métrage. Elle procure à elle seule, la majorité de ressenti du film. Bref, Insane est un film d’horreur des plus convenus. Le rythme patauge longtemps avant que l’on puisse savourer l’affrontement tant attendu. S’il n’y avait pas eu cette musique et ces quelques incursions inquiétantes de Poppy, le père de cette engeance, nul doute qu’Insane n’aurait pu échapper à la catastrophe. Au lieu de cela, on se retrouve avec un film moyen et bancal où les bonnes idées côtoient une intrigue que l’on a beaucoup trop vu par le passé pour être surpris ou impliqué.
Publié le 30 Décembre 2010
Shyness Machine Girl
Noriko, la meilleure amie D’Ami, est ressuscité par Suguru, recousu par on ne sait quelle magie. Petit spin-off décliné en court-métrage, Shyness Machine girl propose une histoire alternative à Machine girl. Principalement destiné à l’exploitation vidéo (il se trouve dans les bonus du DVD japonais et sera également disponible en VOST dans le zone 2 qui sortira prochainement en France), l’histoire reprend grosso-modo les mêmes éléments qu’y font la réputation de son prédécesseur. En d’autres termes, des passages gores comme le cinéaste nous a déjà habitués et une bonne dose de fun pour montrer qu’il s’agit avant tout d’une franche rigolade. L’ensemble se veut complètement déjanté. Les scènes aussi improbables que succinctes (court-métrage oblige) s’enchaînent sans s’attarder sur d’éventuels problèmes de cohérences. On dénotera une touche amateur pour souligner les trucages ou même certains coups en arrière plan que l’on voit qu’ils ne sont pas portés. N’oublions pas également le jeu d’acteurs démesurés des protagonistes qui n’a rien à envier à l’imagination subversive et disjonctée du metteur en scène. Bref, les personnes ayant apprécié Machine girl seront ravis de ce supplément. A contrario, ceux qui n’adhèrent pas au style d’Iguchi et consort (au hasard, son grand ami Yoshihiro Nishimura) n’ont aucun intérêt à le visionner.
Publié le 30 Décembre 2010
The Machine girl
Une jeune fille décide de se venger d’un gang de yakusa qui a tué son frère et son ami pour le plaisir. Elle décide de faire équipe avec la mère de ce dernier pour mettre fin aux agissements de cette famille de psychopathes. Sorti la même année que Tokyo gore police, Machine girl s’inscrit trait pour trait dans le même registre. Nous sommes en présence d’un type de cinéma bien particulier qui réunit à la fois un style typiquement japonais à un gore outrancier qui submerge l’histoire. On l’aura compris, le récit n’est qu’une prétexte à cette vengeance qui prend des allures de batailles rangées entre yakusa et famille des victimes. C’est idiot, sans doute de mauvais goût, mais cela ne se prend pas une minute au sérieux. Fort heureusement serait-on en droit de pensée car un traitement plus sobre aurait périclité le film dans la nullité la plus absconse. Les aficionados de Yoshihiro Nishimura y trouveront leur quota d’hémoglobine et de tripailles, le reste n’étant que secondaire ou anecdotique. Machine girl est donc un spectacle qui se réservera sans doute à une minorité. Malgré sa générosité, la réalisation se veut perfectible sur bien des points. Notamment le rythme qui pâtit de régulière baisse et des effets spéciaux que nous qualifieront de médiocre. Que cela concerne les démembrements ou l’incrustation d’images numériques hideuses, on ressent fortement l’utilisation de procédés grossiers et maladroits ; parfois dissimulé comme il se doit, mais le plus souvent grossièrement. Si l’on peut reprocher cette maladresse au niveau de la forme, on ne peut dénigrer une indéniable sincérité dans les intentions de Noboru Iguchi. On sent la signature généreuse d’un passionné. Bref, Machine girl est un film destiné à un public restreint. Les amateurs de gore s’en donneront à cœur tandis que les newbies risquent d’halluciner devant un tel déluge de sang et d’une histoire qui ne recèle rien de mémorable. Particulier.
Publié le 30 Décembre 2010
The Dead Outside
Une épidémie virale a ravagé la population mondiale. Touché par la folie, ils sont devenus violents et imprévisibles. Dans ce monde à l’agonie, Daniel trouve refuge dans une ferme isolée. Il y fait la connaissance d’April, jeune femme introvertie. Peu à peu, la vie s’organise au sein de leur petit sanctuaire. Tout comme 28 jours plus tard ou plus récemment Infectés, The dead outside reprend la thématique d’un monde agonisant face au ravage d’un virus. Point de zombies néanmoins, puisqu’ici il s’agit de personnes psychotiques qui errent dans les rues et les vallées campagnardes. La nature du virus n’est pas véritablement expliquée, ni son mode de propagation. Seulement connaît-on le symptôme de la folie. Les infectés perdent la tête et débite des phrases insensées. Toujours est-il qu’ils sont des plus dangereux, quoiqu’un peu stupide.
Rapidement, on se rend compte que le premier long-métrage de Kerry Mullaney ne ploiera pas sous un florilège d’action. On ne ressent pas forcément l’oppression des infectés alentours et pour cause, ils se font plutôt rares dans la région. L’histoire se déroulera alors sur un rythme posé, pour ne pas dire lent. Si l’on peut trouver ce choix gênant pour la suite des évènements (manque de tension…), les deux personnages principaux possèdent suffisamment de personnalités pour que l’on s’intéresse à eux. Ainsi, le récit prend une tournure plutôt intimiste. On parvient facilement à s’attacher au personnage qui ne sont ni naïfs, ni insouciants. En d’autres termes, ils sont conscients de leur situation désespérée, mais continue à vivre comme ils le peuvent.
Tour à tour ponctué par quelques interventions extérieures pour que l’histoire ne s’englue pas dans l’ennui et de temporisations sur le passé de Daniel et April, The dead outside parvient à créer une atmosphère délétère où le monde n’est plus. S’il ne révolutionne pas le genre, il se révèle sans aucun doute un film attachant et inventif au niveau de la technique pour dissimuler d’éventuels carences de budgets. Certains pesteront contre sa lenteur mais, dans le cas présent, elle n’est pas synonyme de manque d’idées ou de contemplation prétentieuse. Ici, la lenteur permet de se poser et de faire l’état des lieux de notre existence et du monde qui nous entoure. Ce petit aspect psychologique apporte de l’épaisseur autant aux personnages qu’à l’histoire.
Bref, The dead outside est une première réalisation réussit. Entre un traitement intimiste et des personnages crédibles, l’histoire tisse des liens que l’on se surprend à déceler au fur et à mesure qu’elle progresse. La toile de fond sur la contamination conserve néanmoins la majorité de ses mystères ; se révélant davantage comme un moyen de rapprochement entre deux êtres plutôt comme le véritable tenant du scénario. Il en résulte un métrage parfois déconcertant, mais surtout prenant dans lequel on parvient sans mal à s’impliquer. Pas forcément original, mais d’une indéniable curiosité.
Publié le 29 Décembre 2010
The Door - La porte du passé
Un peintre découvre une porte qui lui permet de retourner cinq années dans le passé. Il va se servir de cette seconde chance pour sauver sa fille et reconstruire sa vie. Heureux lauréat du grand prix au festival de Gérardmer en 2010, The door intrigue de par son histoire, mais également des chemins qu’il va emprunter pour parvenir à capter l’attention du spectateur. Avant tout, The door est une quête de rédemption. Celle d’un homme qui, de par son égocentrisme, provoque la mort de sa fille. La seconde chance qui s’offre à lui se révèle davantage salvatrice que réparatrice. Mais il s’agit également de la rédemption d’un couple au bord du naufrage qui redécouvre en l’autre un intérêt réciproque qu’ils avaient oublié.
Au milieu d’une approche très clairement accès sur la dramatisation et la tragédie de la situation, le cinéaste nous offre un panel de choix qui s’offre à nous durant notre existence, mais que bien trop souvent, on ne remarque pas. On se rend toujours compte de l’importance de ce que l’on possède quand on le perd. Toutefois, cette remise des compteurs à zéro à un prix et non des moindre. Paradoxal dans sa signification, cette ancienne vie que l’on peut qualifiait d’idyllique demande le sacrifice de soi (au sens propre et figuré) pour espérer renouer avec un passé moins sombre. Contrairement à d’autres films, le passé est synonyme d’insouciance et de bonheur. L’avenir, lui, se veut davantage sombre et désespérée. Dans cette dualité, les personnes du « futur » représentent l’égoïsme et la pensée rétrograde tandis que le celles du passé sont enclavées dans l’inconnu de leur vie.
Ajoutons à ce foisonnement de thématiques, une réalisation sobre et un casting irréprochable (incroyable Mads Mikkelsen) pour obtenir un film perdu dans les limbes du temps où passé et avenir se conjuguent afin de nous octroyer d’une intrigue fascinante. On pourra lui trouver quelques ressemblances sur le fond avec L’effet papillon où la connaissance de l’avenir n’est pas toujours synonyme de bénédiction. Voilà un film qui dispose d’une histoire étrange à mi-chemin entre le voyage temporel et l’hypothétique existence des mondes parallèles afin d’octroyer au protagoniste une véritable prise de conscience. Tortueux, complexe sur le plan de la réflexion et d’une indéniable force, The door mérite amplement que l’on prenne le temps de le découvrir.
Publié le 28 Décembre 2010
Transplantation
Après une transplantation cardiaque, un paisible père de famille voit son quotidien bouleversé par de troublantes visions. Il ne peut l’expliquer, mais il connaît les meurtriers du donneur d’organe. Rapidement, lesdites personnes vont mourir dans d’étranges circonstances. Davantage cantonné aux productions télévisées (Six feet under…), Michael Cuesta décide d’adapter une nouvelle d’Edgar Poe avec pas mal de modifications pour la remettre au goût du jour. Ne connaissant la nouvelle que de nom, je ne peux me prononcer sur le respect de l’œuvre originale ou si, à sa manière, Tell Tale lui fait honneur.
Toujours est-il que l’on retrouve une personnalité à double-tranchant en la personne de Terry. D’un côté un père de famille attentionné et soucieux de sa fille. De l’autre, un assassin impitoyable. Plus qu’à la nouvelle d’Edgar Poe, on songe à Docteur Jekyll et Mr Hyde de Stevenson où la nuit éclaire les ténèbres qui sommeillent en chacun de nous. Tell tale joue avant tout sur l’aspect psychologique du sujet en octroyant au cœur une volonté propre, pour ne pas dire une conscience individuelle. Qui est maître de l’autre ? Comment réagir lorsque le cœur qui nous anime n’est pas le nôtre ?
Autant d’interrogations que l’on se pose face à un traitement lancinant, parfois mélodramatique, mais toujours fascinant tant sur la « vengeance » du receveur que sur un quotidien bien plus morose et impitoyable où la véritable force réside à surmonter chaque journée écoulée. Bien sûr, Tell tale n’est pas exempt de tout reproche. On peut déceler une certaine redondance dans la succession jour/nuit ; la monotonie quotidienne laissant la place à des meurtres tout aussi répétitifs. Notons également que le « cerveau » (sans vouloir faire de mauvais jeu de mots) de l’histoire manque cruellement de charisme. Un anonyme qui se prend pour Dieu.
Bref, Tell tale jouit d’une histoire qui sort de l’ordinaire. Si l’originalité n’est pas omniprésente, il faut reconnaître que le récit parvient à nous happer sans trop de difficultés dans les méandres obscures de l’âme humaine. Mis à part quelques menus écueils, le film de Michael Cuesta se révèle une production sombre et intéressante sur bon nombre d’aspects. On aurait aimé que la réflexion et l’aspect psychologique soit encore davantage poussé, même si il se révèle déjà assez développé dans son ensemble. N’oublions pas un final qui en surprendra plus d’un et ira jusqu’au bout du concept… ou peut-être pas.
Publié le 26 Décembre 2010
A la poursuite du passé - Jesus Code
Un archéologue découvre en Israël un squelette qui ne peut dater de 1 800 ans. En fouillant le site, il découvre le mode d’emploi d’une caméra vidéo qui n’existe pas encore. Cette découverte sans précédent attise les convoitises de personnages peu scrupuleux. Adaptation du roman Jesus video (tout est dans le titre), Ancient relic est une mini-série télévisée qui joue à la fois la carte de l’aventure, du thriller ésotérique et d’un soupçon de science-fiction. Dit comme cela, on peut trouver l’ensemble indigeste, mais il n’en est rien. Sans remettre en doute les fondements de l’église (quoique…) comme le fera par la suite le Da Vinci Code et bon nombre de ses successeurs, Ancient relic décide de plonger son intrigue dans le surnaturel. En effet, il ne faut chercher d’explication rationnelle à la découverte archéologique. Une fois avertie de cela, on peut plonger dans l’aventure qui, malgré quelques longueurs négligeables compte tenu de la durée du film (trois heures), enchaîne les péripéties avec vélocité sans que rien ne paraisse saccadé ou décousue. Si la véracité historique et donc, la vie de Jésus n’occupe qu’une place mineure, pour ne pas dire anecdotique, c’est pour mieux se concentrer sur l’affrontement en les deux camps. Tandis que l’un désire préserver le secret, d’autres désirent simplement le détruire pour effacer toute trace de cette « hérésie ». On pourra néanmoins regretter que certains passages à l’utilité pas toujours probante n’est était raccourci ou bien que les spécifications du voyage dans le temps ne soient pas plus élaborer car, dans un tel sujet, il est très facile de se perdre en incohérences ou en manque d’explications. Ancient relic n’échappe pas à cet écueil, même s’il est minime. Pour ne rien spoiler, je ne peux illustrer d’exemples, mais le final en recèle suffisamment. Quelques interrogations demeurent tandis que ce happy-end paraît un peu trop simpliste. Bref, Ancient relic est un film principalement axé sur l’aventure qui fait un petit détour vers d’autres genres. Loin d’être prétentieux ou ennuyeux, l’histoire insolite, voire improbable, parvient à capter notre attention sans difficulté. Malgré des défauts mineurs, on passe un bon moment dans les contrées d’Israël à la recherche de la relique la plus high-tech de toute l’histoire.
Publié le 25 Décembre 2010
Affamés
Cinq inconnus se retrouvent séquestrés dans des souterrains. Ils disposent de suffisamment d’eau pour survivre un certain temps, mais n’ont aucune nourriture à disposition. S’il ne s’agit pas du premier film de Steven Hentges, Hunger marque sa première incursion dans le cinéma d’horreur. Dans un genre où tout semble avoir était examiné sous toutes les coutures, il est de plus en plus difficile de déceler la perle rare qui sort des chantiers battus. Si le fond de l’histoire demeure convenu (un psychopathe qui décide d’observer les réactions humaines face à une situation donnée), le traitement se révèle tout autre.
Le film débute sur une séquence de plus de 15 minutes dans une obscurité permanente. On ne voit presque rien, des voix chuchotent, appellent à l’aide. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? L’immersion est au rendez-vous et ce, dès les premiers instants du film. Pour un huis-clos, la principale difficulté est de réussir à tenir la longueur qui plus est, si la durée excède les 100 minutes, ce qui est le cas ici. On n’échappe pas aux habituels conflits intergroupes, mais le plus surprenant est de constater avec quel savoir-faire le réalisateur nous plonge dans la tourmente de ces cinq individus. Malgré un cadre unique et une histoire qui peut rapidement tourner en rond, on ne s’ennuie quasiment jamais grâce à une astuce simple, mais ingénieuse.
Plutôt que de faire évoluer l’intrigue dans l’espace (un parcours pervers dans les méandres de souterrains), elle progresse dans le temps (une étrange horloge amorce chaque jour passé dans cet endroit). De fait, la tension monte crescendo, une routine malsaine s’installe tout en variant les points de vue et les situations. Les caractères s’exacerbent pour fomenter des plans aussi machiavéliques qu’ignobles. Pour accentuer ce sentiment délétère, quelques incursions du psychopathe ajoutent une touche de voyeurisme au récit via des caméras disposées un peu partout pour qu’il se délecte du « spectacle » ; en d’autres termes, il est le maître incontesté du destin de ces pauvres hères impuissants.
Au lieu de nous resservir l’habituelle tuerie d’un fou furieux, le réalisateur opte pour une approche davantage pernicieuse. Concrètement, le responsable de la séquestration ne tue personne. La destruction vient au sein du groupe par l’émergence des instincts primaires qui sommeillent en chacun d’eux. Déchéance et loi du Talion prévalent pour survivre à tout prix. Grâce à un traitement sans concession, Steven Hentges parvient à créer une ambiance macabre. Hunger n’est pas forcément innovant sur tous les points, mais il parvient à immerger le spectateur dans un tourment de dilemmes tous plus cruels les uns que les autres de par une thématique qui a rarement été abordé sous cet angle.
Publié le 24 Décembre 2010
Skyline
La planète est envahie par les extraterrestres. A Los Angeles, la bataille fait rage et les survivants s’organisent pour se faire oublier des sales petits envahisseurs de l’espace. Au duo de réalisateurs, l’on doit déjà le sombre souvenir de la suite d’Alien Vs Predator. Une séquelle inutile qui finissait de péricliter la franchise vers le bas. Mais avant tout, les frères Strause sont des techniciens d’effets spéciaux qui ont travaillé sur les plus grosses productions de ces dernières années (300, 2012, Avatar…).
Pour leur second long-métrage, l’on ne s’attend guère à un scénario fouillé où l’imprévisibilité est maîtresse des lieux. D’ailleurs pourquoi essayer de concurrencer des films dans un registre si particulier et brinquebalant si l’on ne le maîtrise pas ? Pour cela, préférez-lui District 9 ou le très récent Monsters, deux métrages singuliers et ô combien profond sur le plan de la réflexion. En ce cas (et si l’on ne réfère pas à des bandes-annonces qui font miroiter de fausses promesses), on peut déceler en Skyline un divertissement de bon augure qui vaudra surtout pour ses qualités graphiques. Pour un budget somme tout modeste (10 millions de dollars), le travail effectué se révèle des plus soignés. Les vaisseaux spatiaux ou les créatures disposent d’un design impressionnant, mais peu inspiré.
En effet, il faut reconnaître que le manque d’idées scénaristiques se mêle avec une curieuse impression de déjà-vu et pour cause ! En ce qui concerne le design général des créatures, il ne sera pas étranger aux amateurs de jeux-vidéos. Le nom de Gears of war vient en tête, mais c’est surtout celui de Resistance que l’on retiendra. Les références à la franchise d’Insomniac games sont plus que flagrantes tout au long du récit. Que cela soit dans le « fonctionnement » du vaisseau-mère ou les créatures gigantesques, on ressent une réelle influence dans Skyline. N’oublions pas d’ajouter une multitude de clins d’œil aux films similaires ; Independance day, La guerre des mondes… A noter que l’histoire se conclut sur un final passablement grotesque compte tenu de ce qui avait été amorcé. Ainsi, l’on se retrouve avec un dénouement qui appelle irrémédiablement une suite.
Vous l’aurez compris, il manque une identité propre au film des frères Strause. Skyline n’est pas mauvais et se révèle même divertissant si l’on excepte un scénario simpliste et sans surprise. Toutefois, on se retrouve davantage devant une vitrine technologique alléchante plutôt qu’un film original avec de véritables enjeux. Il faut faire l’impasse sur bon nombre d’écueils pour savourer ce film. Ce sera certainement beaucoup demandé, mais il demeure néanmoins une production sans prise de tête qui privilégie le spectaculaire à la jugeote. Un potentiel perfectible.
Publié le 23 Décembre 2010
Retour au Loch Ness
Tim décide de revenir sur les rives du Loch Ness avec son père pour les grandes vacances. Sur place, il retrouve Oki, son fidèle ami. Ensemble, ils vont devoir affronter une bande de mercenaires gauche pour préserver le secret le mieux gardé de tous les temps. Suite du très moyen et niais Le secret du Loch Ness, ce retour refait surface dans les mêmes conditions que son aîné. Michael Rowitz revient derrière la caméra pour cette nouvelle aventure familiale. Il n’est pas nécessaire d’avoir vu le premier volet pour regarder celui-ci et, serais-je tenter de dire, il serait plutôt préférable de faire l’impasse. En effet, une curieuse impression de déjà-vu serpente ces contrées forestières du Loch. Intrigue rachitique, nouvelle quête sans grand intérêt et méchants de services très patauds, pour ne pas dire stupides, il faut reconnaître que les scénaristes n’ont pas grandement puisés dans leur ressource pour nous pondre cette histoire bon enfant ; le film se destinant avant tout à un public familial où les plus jeunes seront comblés, ceci explique peut-être cela. De fait, il en ressort une aventure simpliste où certains éléments du premier opus ressurgissent ici sans le moindre scrupule. Un procédé facile des plus discutables que l’on ne saurait cautionner. En ce qui concerne ce bon vieux monstre du Loch Ness, il se fait plutôt discret. Un long cou, l’ondulation de l’eau, un saut de cabri dans les airs et… rien d’autre. En tout et pour tout, il ne sera apparu pas plus d’une minute à l’écran. Pour un film qui traite du mythe, voilà qui est plutôt gênant. Bref, Retour au Loch Ness est une suite qui se contente simplement de reprendre les mêmes éléments que son prédécesseur sans rien y changer. Devant sa simplicité, son manque d’envergure et un récit peu amène, le nouveau film de Michael Rowitz sera destiné au plus petit ; disons une tranche d’âge comprise entre trois et huit ans. Au-delà, on se rend compte de la supercherie d’une production minimaliste et peu impliquée dans un résultat final des plus médiocres.
Publié le 22 Décembre 2010
Le Sorcier du Nepal
De retour d’un voyage au Népal, Joe fait la rencontre de la mystérieuse Sheila. Celle-ci lui apprend qu’il doit lutter contre les forces du mal grâce à des pouvoirs mystiques. Entre eux, une idylle ne tarde pas à naître. Avant de s’atteler à la saga Histoires de fantômes chinois, Ching Siu-Tung s’attelait déjà au mysticisme avec ce Witch from Nepal. On s’étonne alors que ce film est demeuré dans l’oubli quand l’on voit l’illustre réputation (amplement mérité) d’Histoires de fantômes chinois. Si le début ne laisse rien paraître, au fil de la progression du récit, on se rend compte que Witch from Nepal est bien loin de nos espérances.
Relativement lent, le scénario ne s’encombre pas de dialogues patauds ou redondants. Le cinéaste préfère couper court aux discussions de pacotilles. Aussi, très peu de communication par le biais de la parole. La majorité du ressenti se fait dans le regard, une attitude ou un geste. Ce genre de procédé sied à merveille pour les histoires à l’eau de rose où le romantisme est omniprésent. Malheureusement, la quête principale s’efface assez rapidement au profit de cette idylle où Joe se retrouve tiraillé entre son amour et cette jeune inconnue. Ainsi, l’on se retrouve avec un film très fleur bleue, préférant compter pâquerette plutôt que de se pencher sur la menace imminente qui pèsent sur leurs épaules.
Là encore, on se retrouve désemparé face à une approche plutôt bâclée et sans saveur. La quête du bien et du mal dans ce qu’elle recèle de plus basique n’a rien de transcendant. Aucun dilemme cornélien, pas de rebondissements de dernières minutes. Le réalisateur ne se contente que du strict minimum. Même les personnages n’ont rien de marquants. Héros, jeune femme en détresse et grand méchant qui ne sait que miauler à chaque plan où il apparaît. Tout cela paraît bien fade au vu de la réputation du cinéaste et de sa tête d’affiche. Si la filmographie de Chow Yun-Fat n’est pas exempte de tout reproche, elle se révèle quand même nettement au-dessus de bon nombre d’acteurs. Force est de constater que Witch from Nepal fait partie de ses films les moins mémorables.
Bref, Witch from Nepal est une production hong-kongaise décevante. Romantisme exacerbé, histoire sans tension et sans réels enjeux, protagonistes sans saveur. Nul doute que le temps n’arrange pas des défauts déjà bien handicapants à la base. En somme, il recèle tout ce que l’on peut faire de plus basique. Vingt-cinq se sont écoulés et il est difficile de faire l’impasse sur ses nombreuses lacunes. Seuls les effets spéciaux, un brin désuet, offre un charme suranné à l’ensemble ; ce qui, vous en conviendrez, est bien peu pour sauver le film. A présent, on comprend mieux pourquoi le film est passé inaperçu.
Publié le 21 Décembre 2010
Vampire Girl vs. Frankenstein Girl
Après le disjoncté Tokyo Gore Police, Yoshihiro Nishimura récidive de fort belle manière avec ce Vampire girl Vs Frankenstein girl en collaborant avec un réalisateur également très particulier : Naoyuki Tomomatsu (Stacy). Un titre évocateur des réjouissances qui nous attendent par la suite. Tout comme son prédécesseur, les premières minutes donnent le ton d’une expérience complètement folle. Le réalisateur ne déroge pas à la règle du grand n’importe quoi dans un joyeux festival de gores, de tripes et de combats survoltés. L’intrigue, toujours aussi simpliste, prend place dans un lycée japonais. Lieu des exactions d’un savant fou qui se prend pour le digne héritier du docteur Frankenstein en personne et le terrain de chasse d’une séduisante vampiresse aux allures de sainte nitouche. Nul doute que ces deux camps seront amenés à s’affronter et plus si affinités. Contrairement à ce que l’on avait pu constater dans Tokyo gore police, on remarque davantage de cohérences dans l’enchaînement des séquences. Même si l’histoire ne possède rien de fondamentalement originale (mis à part le tournoi de tailladages de poignets !), on peut saluer l’effort qui a été fait sur la narration. Le rythme s’en retrouve grandit. Le surréalisme est de mise et ce, dans la quasi-totalité des séquences. Démembrements, danse extatique sous une pluie d’hémoglobine, sans oublier un affrontement final des plus hallucinants, rien ne nous est épargner. A chaque instant, l’on se dit que les limites sont atteintes, voire dépassées, mais il ne faut pas plus de deux minutes pour nous prouver le contraire. Voir pareil déferlement d’incongruité à chaque minute se révèle tout simplement jouissif. N’oublions pas un foisonnement de clichés qui finit de parfaire une ambiance des plus saugrenues. Bref, Vampire girl Vs Frankenstein girl est le digne successeur de Tokyo gore police. Davantage soigné sur le plan narratif, il n’en reste pas moins que le film demeure toujours aussi barré. Un style décidément très japonais, parfois déstabilisant, mais ô combien jouissif si tant est que l’on adhère au concept du mauvais goût et du gore à outrance ; nul doute que les amateurs s’en donneront à cœur joie.
Publié le 20 Décembre 2010
TGP : Tokyo Gore Police
Dans un avenir proche, la police de Tokyo est privatisée. Dans ce monde futuriste, une race de mutant sème la terreur au sein de la capitale japonaise. Ruka semble être la seule à pouvoir endiguer la menace. Fort d’une réputation qui le précède, Tokyo gore police se destinera à une catégorie très spécifique du cinéma de genre. De par sa volonté à user, ou plutôt abuser, du gore, dans une histoire pour le moins bancale et simpliste, le film de Yoshihiro Nishimura plaira aux amateurs de productions en marge des traitements plus classiques. Le réalisateur dispose d’une véritable prédilection pour le gore outrancier via des séquences pas toujours cohérentes entre elles, mais véritablement fun et décomplexée jusqu’à la moelle. On ne se prend pas une minute au sérieux sur la forme, même si, paradoxalement, le ton du film ne prête pas forcément à rire. Le mal-être des japonais et les tendances suicidaires sont un véritable problème de société que l’état peine à endiguer. Monsieur Nishimura dissèque avec les sabres et les tronçonneuses un quotidien morne et sans espoir d’une population désabusée. Cela reste mineur dans le récit, mais bel et bien présent. En ce qui concerne le reste, il s’agit d’un joyeux moment d’absurdité et d’incongruité où la surenchère prévaut sur toute autre considération. Le film assume totalement ce qu’il est. En d’autres termes, une véritable jouissance pour assouvir l’appétit insatiable des amateurs de gores via un scénario basique. De par certaines scènes, il rappellera sans doute le Meatball machine de Yûdai Yamaguchi. Il s’agit du même style totalement fou ou l’invraisemblable côtoie l’horreur dans toute sa splendeur. On pourrait trouver le film extrême – ce qu’il l’est sans doute aux yeux du public – mais le réalisateur se contente simplement de pousser l’idée de départ à son paroxysme. Bref, Tokyo gore police dispose d’un style très marqué. Les hectolitres de sang fusent de la première à la dernière seconde. On regrettera un rythme maladroit dans un ensemble qui manque de cohésion. Subversif et d’une indéniable irrévérence, une frange du septième art qui demeure à part, pour ne pas dire marginal. Cela plaira ou pas.
Publié le 19 Décembre 2010
Cornered!
A Los Angeles, un tueur en série sévit en toute impunité. Les employés d’une épicerie imaginent ce qu’il pourrait bien lui faire s’il leur tombait entre les mains. Seulement le tueur a tout entendu et compte bien les tuer de la même manière. Une fois n’est pas coutume, un tueur psychopathe prend un petit groupe de personnes à partie pour une petite boucherie conviviale. Rien de bien nouveau sous le soleil de Los Angeles, même si certains aspects tendent de se démarquer des prédécesseurs du genre. Tout d’abord, nous ne nous trouvons aux confins d’une nature hostile puisque nous sommes en plein milieu de la banlieue de Los Angeles, dans une épicerie. Cela change des habituelles forêts et autres îles reculées. Mais cela ne suffit pas forcément à faire de Cornered un bon film. Même si l’on peut louer également une certaine recherche dans les meurtres, l’intrigue tourne rapidement en rond. Les limites du scénario se font ressentir dès la partie de poker engagée. Pour faire simple, un joueur descend dans l’épicerie, il fait la rencontre de trop et meurt dans d’horribles circonstances. Ainsi de suite, tous les protagonistes vont passer à la moulinette sans que les autres ne se rendent compte de leur absence prolonger. Un procédé des plus discutables qui se montre rapidement agaçant. Ce n’est que bien trop tard que les joueurs réagissent promptement. Une piètre manière de faire aboutir une histoire somme toute banale si l’on excepte la méthode employée pour tuer les victimes. De l’imagination dans les meurtres certes, mais il aurait fallu la placer également dans un rythme davantage constant et des situations variées. Bref, Cornered n’est ni un très mauvais slasher, ni un bon titre. On est simplement en présence d’une production lambda qui s’adresse avant tout à un public amateur du genre et seulement pour eux. Rien de transcendant, mais rien de catastrophique non plus. Au vu de la qualité de la concurrence, Cornered se trouve dans la moyenne du genre.
Publié le 18 Décembre 2010
Pages |











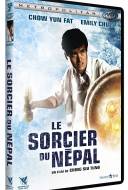






![La Nuit de la comète [Édition Collector Blu-Ray + DVD + Livret] La Nuit de la comète [Édition Collector Blu-Ray + DVD + Livret]](https://www.horreur.net/sites/default/files/styles/vertical-grand/public/upload/nuitcomete_bd_rimini.jpg?itok=cfnFyIUX)