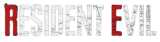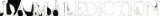Critiques spectateurs de Frank zito
Pages |
Peur Bleue
Une paisible bourgade du Maine se trouve terrorisée par la sauvagerie d’un loup garou insaisissable. L’adaptation d’un des ouvrages les moins intéressants de Stephen King pouvait présager du pire, et les critiques de l’époque ne furent pas tendres avec le film de Daniel Attias. Pourtant, vingt ans après, force est de constater qu’il a plutôt bien vieilli. De facture extrêmement classique, il distille les thèmes chers à King comme la foi, l’adolescence et la différence avec application. La petite communauté, parfaitement croquée, place le spectateur dans une situation aussi familière que confortable. On suit ainsi sans ennui notre jeune handicapé jouer au détective dans sa laborieuse enquête. On frissonne juste ce qu’il faut devant la poignées de meurtres plutôt bien amenée. Et si l’on n’est guère surprit par la chute, on savoure comme il se doit la transformation réussie d’homme à loup garou que l’on a espéré tout le film. Il est pourtant bien évident que sans la nostalgie qu’il réveille, Peur Bleue, accompagné d’une bonne camomille, prendra pour les plus jeunes l’apparence pantouflarde d’un épisode de l’inspecteur Barnaby. Et le vieux spectateur de se dire putain, comme le temps passe…
Publié le 9 Mars 2008
Batman: le film
Batman et son fidèle Robin doivent faire face au plus grand danger que la terre n’ai jamais eu à affronter : une union de la pègre de Gotham City derrière le Pingouin. Et c’est parti pour le show : missiles à énigmes, bombes de dessin animé, escalades d’immeubles façon Benny Hill, super pastilles aveuglantes, pilules anti-gaz de pingouin azoté, pirates sous marins, dignitaires déshydratés et retournements de situation à la scoubidou ! Et bien sûr les déguisements aussi loufoques que moules-burnes de nos héros. Batman, film insensé et burlesque par excellence, a été tourné par Martinson de manière totalement décomplexée. Les acteurs y cabotinent plus encore que dans « Plus belle la vie » (Il faut voir l’homme mystère, cat-woman, pingouin et le Joker danser la bourrée à chaque manœuvre réussie, où les magnifiques et apartés verbeuses de Batman et Robin pour s’en convaincre) le tout dans des décors de carton pâte et des costumes dignes d’une kermesse d’école primaire. Un film foutraque, qui lorgne sans cesse vers Tex Avery, tellement fou qu’on imagine mal un tel projet se monter aujourd’hui. Salutaire, et surtout bien meilleur que le prétentieux Batman Begins de Nolan. Si vous préférez les ambiances de fête foraine hallucinée à une atmosphère plus pompeuse que crépusculaire, alors jetez vous sur ce Batman. Le seul. Le vrai !
Publié le 7 Mars 2008
The Roost
Afin d’échapper à un embouteillage monstre, un groupe de jeunes étudiants en route pour le mariage d’un camarade, emprunte un raccourci qui va les mener tout droit dans la tanière de chauves souris bien peu coopératives. Sur ce postulat plutôt classique, Ti West tente de trousser une série B qui réunirait la modernité du cinéma indépendant US au cinéma d’horreur pop corn des eighties. Le premier point commun étant l’économie de moyen avec laquelle le réalisateur a visiblement jonglé. Malin, il baigne son métrage dans une obscurité bon marché en décors dont il tire un parti intéressant, jouant des ombres qui enveloppent les acteurs avec intelligence. Son groupe de jeunes, plutôt moins neuneus qu’à l’ordinaire, s’embourbe gentiment dans sa galère, et l’on suit le tout sans vraiment s’ennuyer, aidés en cela par quelques contre-pieds narratifs et un bon esprit général. Hélas, Ti West n’est pas Sam Raimi, et là où son aîné avait réussit, malgré la faiblesse du budget, à tenir son Evil Dead sous une tension permanente, The Roost, pourtant très court, s’étire jusqu’à s’effilocher sous le coup d’une réalisation sans relief et d’un scénario bien faiblard. Si les maigres effets spéciaux sont réussit, ils n’arrivent tout de même pas à sauver le film de sa narration paresseuse. The Roost, après une exposition réussie donc, ne décolle jamais et laisse un goût fadasse au spectateur. Celui d’un triste jour sans pain. Celui d’un cinéma de genre tiède que Mad Movies encense à longueur de numéro sans que l’on comprenne vraiment ce qu’ils lui trouvent.
Publié le 7 Mars 2008
Les Tueurs de la lune de miel
Une jeune infirmière laide et frustrée s’entiche d’un gigolo dont le gagne pain consiste à séduire des femmes isolées qu’il dépouille après les avoir épousées. Dévorée par la jalousie, Martha Beck va transformer ce qui n’était qu’une aimable escroquerie en folie meurtrière… Filmé au plus près de ses personnages, « les tueurs de la lune de miel » dérange immédiatement par l’intimité qu’il nous impose. Le réalisateur ne nous épargne rien, le malaise étant accentué par la relation frère/sœur que Martha imagine pour justifier sa présence lors des voyages de noce. Et le spectateur d’en être réduit à regarder par le trou de la serrure. Martha qui se coiffe, qui traverse le salon en déshabillé sans rien cacher de la lourdeur de son corps, qui se goinfre sur son lit. Raymond qui ajuste sa perruque, utilise sa brillantine, fait des pompes en débardeur, s’admire dans les miroirs. Et les fiancées qui défilent avec leurs habitudes, leurs rituels, leur triste banalité. Jusqu’aux meurtres qui ne sont qu’alimentaires. L’absence de romantisme et de noblesse dans la caractérisation en ont fait l’un des films les plus moderne de sa génération, l’un des plus provocant aussi, tant l’humanité y apparaît comme inutile et méprisable. Jusqu’au sentiment d’amour qui uni les deux protagonistes seulement traduit que par la jalousie, les menaces, l’infidélité et la trahison. Une histoire sans héros, sordide et démystificatrice. Inoubliable.
Publié le 22 Février 2008
The Jacket
Accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, un vétéran du Vietnam est interné dans un hôpital psychiatrique. Là, son traitement va lui donner accès à une faille temporelle qu’il va utiliser pour échapper à sa propre mort programmée pour les jours à venir… Diable… Drôle de scénario, tout droit sorti d’un épisode de la quatrième dimension. A la croisée des genres, et nanti d’un casting trois étoiles, il y avait de quoi faire. Seulement l’ami Mayburi ne comptait pas réaliser un film jubilatoire, pas plus qu’un honnête film de genre. Non. Lui, il se voyait plutôt faire un film raisonnable et sage, avec des personnages tellement profond qu’ils vous ennuient au premier coup d’œil. Pour tout dire, son histoire, elle l’encombre un peu, Mayburi. Lui, c’est le pathos qui l’excite ! C’est qu’il veut être un vrai réalisateur, de ceux qui rêvent d’oscar et de discours larmoyants ! Il fait pas dans la gaudriole ! Il est pas là pour nous amuser ! Alors plutôt que de garder son métrage sous tension, il préfère exposer sa galerie de personnages neurasthéniques aussi improbables que rasoirs. De la jeune fille engluée dans l’enfer de la drogue au petit autiste qui bave ses maigres repas, il se régale, Mayburi. Et il a trouvé le parfait interprète pour le rôle titre. Faut dire que dans le genre dépressif, il sait faire Adrien Brody ! Ca c’est un acteur, un vrai ! Regardez le se démener pour démontrer que son personnage est plus malin que sa condition ne le laisse penser, que c’est un vrai personnage complexe, à l’aide d’un demi sourire qui donne envie de lui balancer de grandes baffe dans la tronche. Ah ce qu’ils se sont bien trouvés ! Grâce à eux, The Jacket, c’est un « vrai » film, grave et important ! Alors l’espace temps et le thriller, à la trappe ! Et que vive le sentimentalisme puant, les leçons de morales made in Hollywood et la caractérisation concernée à l’outrance ! Bon sang, qu’est ce qu’on peut se faire chier, parfois…
Publié le 3 Février 2008
La Clinique sanglante
Dans un hôpital psychiatrique localisé dans un château isolé, une équipe médicale novatrice ne s’occupe que des femmes (jeunes) dominées par des pulsions homicides ou sexuelles. Bon, pour les pulsions homicides, elles n’y mettront pas beaucoup d’entrain, se limitant pour beaucoup à gesticuler mollement en multipliant des grimaces. Elles se réservent plutôt pour le caractère nymphomane de leur personnage, bien mis en valeur par le titre français, la raison même pour laquelle Fernando Di Léo a tourné son film. Alors il invite ces actrices grassouillettes à se dessaper les unes après les autres sous l’œil libidineux de sa caméra, mais elles ne semblent dévorée que par le désir de prendre leur chèque et de se tirer vite fait de cette galère! Alors à l'image de ce qu'elle faisaient pour la pulsion homicide, elles gesticulent encore mollement et multiplient les grimaces, à la différence prêt que maintenant elles sont nues. D’aucun pourrait croire à une analyse pertinente mélant sexe et meurtre, mais ce n’est en fait que le résultat du manque ahurissant de talent de ces actrices. Filmée sans envie, la chair se fait donc triste sous l’œil d’un Di Léo qui semble accablé, et comme l’histoire du tueur n’était qu’un prétexte à la farandole de gros derrières et de seins mous qui s’étire devant nous, c’est vous dire si on s’emmerde sec ! A voir toutefois pour la prestation impayable de Klaus Kinski, au jeu d’habitude magnétique, et qui semble si péteux de se retrouver là qu’il arrive à se faire discret même quand il est seul à l’écran ! Une performance d’acteur rare !
Publié le 1 Janvier 2007
Cauchemars à Daytona Beach
George Tatum est un schizophrène hanté par des cauchemars que l’on imagine aisément qu’ils ont été vécus. Libéré de l’hôpital psychiatrique dans lequel il était interné, il va fuir vers la Floride et parsemer son voyage de meurtres aussi horribles que graphiques. Enfin arrivé à bon port, il se met roder autour de la maison de la famille Temper... C’est Bred Stafford qui joue George Tatum, est le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est habité par son rôle: suant, tremblant, il trimballe sa silhouette décharnée par l’effet conjugué des psychotropes et de la maladie mentale avec une conviction véritablement effrayante. La réalisation de Romano Scavolini elle aussi est particulièment soignée et inspirée, même s’il a une fâcheuse tendance à abuser du sursaut accessoire et superficiel (Autant dire l’ordinaire des productions de l’époque moins ambitieuses et aboutie que la sienne) qui à tendance à sortir le spectateur de l’ambiance lourde et malsaine souhaite entretenir. Mais ce qui fait que Cauchemars à Daytona Beach fait encore froid dans le dos, c’est l’illustration de l’enfance morbide et cruelle qu’en donne le réalisateur. En effet, le personnage de C.J., l’un des trois enfants de la famille Temper, est détestable, ce que soulignent des scènes d’expositions nous révélant son attirance pour un humour pour le moins douteux et dérangeant. Jamais Scavolini ne se démarquera de cette ligne, maintenant C.J. loin des canons du monde de l’enfance. Et l’on suit cette chère tête blonde abuser les adultes avec une gène d’autant plus grande que rien ne viendra jamais justifier cette attitude. Croyez moi, rarement l’enfance malfaisante n’aura été mise en scène d’une manière aussi impartiale que dans Cauchemars à Daytona Beach. Et ça, c’est un sujet tellement tabou qu’à lui seul il justifie que vous vous jetiez sur ce (très bon) film…
Publié le 1 Janvier 2007
La Maison de la terreur
Un jeune musicien loue une maison isolée pour composer sa symphonie en toute quiétude, hélas un tueur en série va finir par troubler sa tranquille créativité… Et pourtant il en faut beaucoup pour l’inquiéter, l’ami Bruno qu’interprète l’inexpressif Andrea Occhipini. Il flâne dans « la maison de la terreur » avec un flegme qui inspire le respect. Il faut dire que rien ne l’inquiète, Bruno. Des coups de cutters qui lacèrent méchamment ses partitions? Non, ça lui fait rien. Une fille cachée dans son placard en pleine nuit ? Pas plus… Du sang qui coule sur son pantalon ? Un jardinier patibulaire dont la simple vue fout la chiasse? Son mégaphone qui capte des voix inaudible venue d’outre tombe? Y a rien qui lui fait peur je vous dis… Serein qu’il est, Bruno. Entre deux disparitions, il retourne inlassablement jouer quelques notes de piano, les bras ballants et l’air de s’en foutre royalement. Et c’est bien dommage, car Lamberto Bava était à deux doigts de signer un très bon giallo. D’accord il pompe sans vergogne Argento, mais au moins il le fait bien. Et puis pour un film qui n’a été tourné que pour rentabiliser la maison que le producteur venait de s’acheter (Si, si, c’est vrai !) et qui devait être bouclé avant qu’il ne s’y installe avec toute la famille, on peut même parler de franche réussite ! Visuellement très soigné, parfois violent (le meurtre de la salle de bain est d’une brutalité encore éprouvante aujourd’hui) et parfaitement maîtrisé, on regrette d’autant plus ses longs tunnels de dialogue ridicule, le scénario invraisemblable de Sacchetti et ses ballades interminables dans la maison qui cassent le rythme et empêche la pression de monter. Quand ce n’est pas le catastrophique doublage français qui fait chavirer le tout dans la franche pantalonnade. Après tout, c’est aussi pour ça qu’il faut la voir, cette maison de la terreur, pour cette capacité à enchaîner les morceaux de bravoure avec du vaudeville (parfois) et du grotesque (souvent). Les années 80, quoi…
Publié le 1 Janvier 2007
Psychose phase 3
J'avais de Psychose phase 3 le souvenir d'une vidéo louée dans les années 80 qui m'avais procuré une agréable sensation de malaise. Je viens donc de le revoir et je dois avouer qu'il ne m'a pas déçu. En effet, l'image léchée et la réalisation soignée de Richard Marquand n'ont pas particulièrement vieilli. Classique, la mise en place de l'histoire est gentillement énigmatique et l'ambiance raffinée réussie. Toutefois si le scénario est solide et les acteurs convaincants (Sam Elliott en tête, avec un personnage viril et old school avec lequel on se trouve rapidement en empathie car il est, comme nous, étranger au drame qui se déroule) le film souffre d'un léger manque de rythme et d'une mise en scène qui, à cause même de son caractère classique, manque d'audace au moment de souligner les nombreuses mises à morts, pas désagréables et assez originales, qui parsèment le métrage. La musique aussi est à mettre au débit de Psychose phase 3 tant elle est en décalage avec le fond du propos, plombant plusieurs scènes, dont celle de l'escapade des héros au milieu du film, rendue presque ridicule par le hit ultra daté qui la souligne. De plus on peut aussi repprocher a The Legacy d'être un peu "trop propre", pourtant le film fonctionne très bien, d'autant qu'il se trouve valorisé par un final amoral et ambigu loin des clichés contemporain que je vous laisse découvrir. En bref un bon film d'ambiance aux décors et à l'image superbe mais à qui il manque juste un peu de piment pour en faire un grand film.
Publié le 1 Janvier 2007
La Quatrième Dimension - Le Film
Quand « la quatrième dimension » est sortie en salle, au beau milieu des années 80, la déception fut rude. En effet, le film tiré de la série la plus marquante des années soixante, scénarisé par l’immense Matheson, réalisé tour à tour par Spielberg, Miller, Landis et Dante, interprété par Dan Aykroyd, ScatMan Crohers, j’en passe et des meilleurs, bref, tout ce qui pouvait alors se faire de mieux à chaque poste à pourvoir, embarrassa le petit monde du cinéma. Las ! Rien n’y faisait : on ne pouvait s’empêcher de trouver que ce film était un bien grand gâchis… La question que je me posait donc, en m’installant peinardement sur mon canapé, face à mon téléviseur branché sur Sci-Fi, était donc : qu’en est-il de tout ça maintenant que le temps est passé et que l’eau a coulé sous les ponts? Et bien je ne vous mentirais pas : le désenchantement reste (presque) le même, la nostalgie en plus (Ce qui n’est pas rien, et peu s’en fallait pour qu’à l’image de McGrath, j’y cueille cet agréable souvenir d’enfance sans aucune réserve) Car c’est vrai qu’on est heureux de retrouver toute cette tranche du cinéma US des années 80, un peu comme si on enfilait une vieille paire de chaussons bien douillette pour échapper à la froideur du carrelage, le soir venu. Mais l’être humain étant ce qu’il est, il ne peut faire l’impasse sur le casting de rêve précité (Souvenez vous qu’il allait tout de même de Spielberg à Miller nom de nom !) et de ce demander pourquoi, avec un tel générique, il à l’impression de chausser ses savates alors qu’il devrait enfourcher un dragster ? Pourquoi « la quatrième dimension », au lieu de lui retourner la gueule comme une tournée de tequila, lui fait l’effet apaisant d’une tisane? Pourquoi, hein ? Pourquoi ?
Publié le 1 Janvier 2007
Le Silence qui tue
Ouverture: un ralenti hideux accompagne deux flics visiblement sous pression sur le théâtre d’un crime… Tout ce qui fera la qualité du «Silence qui tue» est déjà présent dans cette scène d’introduction : musique de téléfilm raté, image dégueulasse et éclairage maussade, acteurs qui se demandent plan par plan se qu’ils foutent là, jusqu’au réalisateur qui donne dans cette séquence tout ce qu’il a, c’est à dire rien. Après ça, vous vous coltinerez l’arrivée de Scotty qui va louer une chambre dans la demeure de style victorienne de Mrs Engells, laquelle se paye le luxe de n’avoir non pas un seul, mais deux enfants dégénérés qui vont tuer un par un les étudiants qui cohabitent sous leur toit. Ah oui, au fait, ils ne sont que quatre à y louer leur chambre (Peter, Jack, Doris et Scotty) et il vous faut savoir que deux vont finir par s’en sortir. Faites donc un calcul simple : 1h30 de film laid, moche, ennuyeux et pas drôle divisé par deux meurtres exécutés hors champs (l’un en ombre chinoise et l’autre qui nous permet d’apercevoir vaguement un couteau de cuisine maculé parce qui semble bien être de la confiture de groseille) et vous obtiendrez « Le silence qui tue », film interdit aux moins de seize ans à sa sortie (Peut-être justifiée par une pendaison à mourir de rire ? Allez savoir…) et antinomie même du chef d’œuvre (C'est-à-dire le navet, et non pas le nanard, qui peu s’apprécier au second degré). A moins qu’il ne faille se fier à Jack, l’amoureux de Scotty, qui se prend d’une soudaine angoisse nocturne et part toute séance tenante à la recherche de sa dulcinée. Recherche qui nous offrira une promenade d’une bonne dizaine de minutes dans les couloirs déserts de la villa, promenade aussi interminables pour Jack que pour nous, avant qu’il ne finisse enfin par pousser la porte du cellier et lancer dans la nuit de l’escalier, et alors même qu’il n’y a personne : « J’ai compris, c’est une blague ! »
Publié le 1 Janvier 2007
Starman
Jenny noie son chagrin dans l’alcool quand un extraterrestre lumineux s’introduit à son domicile et prend l’apparence de son défunt mari. Bon, d’accord, vu comme ça, ça sent le film à l’eau de rose, genre l’extraterrestre et la Jenny vont lier connaissance, elle devra surmonter cette ressemblance avant de s’y habituer pour ils puissent coucher ensemble avant qu’il reprenne le chemin de Glurk, sa planète d’origine, pour y poursuivre sa vie, non sans avoir redonné tout son courage à Jenny. Et bien c’est exactement ça ! Sauf que c’est Carpenter qui s’y colle. Et là où Starman aurait dû être ridicule et niais, son film demeure naïf et séduisant. Karen Allen et Jeff Bridges sont merveilleux. Et l’on finit par regarder le monde avec les yeux de cet étrange visiteur. Humaniste en diable, Carpenter à comme d’habitude choisi son camps : celui des doux dingues, des clandestins généreux, des serveuses au grand cœur contre l’hostilité des chasseurs beaufs, de l’administration écrasante et de l’autorité arbitraire. Une leçon touchante qui vous redonnera, comme Jeff Bridges le fait pour Jenny, foi en la vie. Et surtout foi en vous, en ce que vous croyiez, envers et contre toutes les règles qui veulent nous asservir sans discernement, par la seule raison du plus fort. Plus qu’un message, une façon de penser et de (bien) vivre.
Publié le 1 Janvier 2007
Wolfen
Un riche promoteur immobilier se fait déchiqueter par des loups alors qu’il batifolait tranquillement avec sa femme dans un parc New-yorkais. C’est Albert Finney qui va enquêter sur ce triple meurtre (La femme et le garde du corps du promoteur y sont également passé). Placide, il promène avec conviction ses traits bouffis et indifférents dans cette histoire parabole sur la place des indiens dans la société américaine. Le regard désabusé de Finney nous représente une Amérique peuplée (voire surpeuplée) de drogués, cyniques, corrompus, mythomanes et décadents de tous niveaux social et de toute espèce. Bref, New York semble bien, sous la caméra de Michael Wadleight, jouer le prélude à une fin de race. Mais Wolfen, c’est aussi cette caméra subjective qui nous place dans la tête des loups, ces cookies engloutis avec bel appétit devant des trépanés, cette galerie de flics aussi blasés que cyniques ainsi que les superbes vestiges dans lequel les loups ont fait leur niche et que l’œil de la caméra fouille avec délice. En plus Wolfen, s’il manque parfois de rythme, à le mérite de nous évoquer cette Amérique sans repère des années 80, gavée de hot dog et de dollars, si éloignée de l’habit de puritanisme dont elle se drape aujourd’hui en laissant entendre qu’elle l’a toujours porté. Bref, un film efficace que le temps n’a pas maltraité, loin s’en faut. Un bon petit cru, quoi.
Publié le 1 Janvier 2007
Maniac Cop 2
On reprend les mêmes et on recommence. Toujours aussi jouissive, cette séquelle ne se démarque du premier que par la volonté de Lustig et Cohen de faire du Maniac cop un super vilain tout droit sorti d’une bande dessinée de chez Marvel. Ils s’amusent comme des petits fous avec le matériau d’origine et ne reculent devant aucune idée, comme celle qui voit ce braqueur gratter, avec l’épicier qu’il tient en joue, des tickets de Morpions pour gagner plus que le simple fond de caisse famélique qui s’offre à lui, ou alors la mort brutale des deux précédents héros de Maniac cop (dont Bruce Campbell) et ce dès le début du métrage. Toujours aussi dense, l’histoire n’ennuie jamais. Mieux même, elle grimpe en tension avec l’incroyable association de psychopathes que scelle le Maniac cop (Toujours Robert Z’Dar, dont la trogne déraisonnable est en plus défigurée par un maquillage encore plus ravagé) avec Steven Turkel, le maniaque barbu qui entend des voix et collectionne les photos de ses victimes. Association qui fait des étincelles et finira dans un embrasement magnifié par des ralentis dantesque sur un Z’Dar que le feu n’incommode guère. Méchant, spectaculaire, fou, le Maniac cop verse dans le cartoon, et entre dans le panthéon des films inoubliables grâce à la musique du générique final : un rap de cité chanté par un gang-members d’opérette en duo avec le maniac cop himself! Si vous ne trouvez pas ça incroyable, c’est que vous êtes vraiment revenus de tout! Alors avec moi, en chœur : pour Cordell hip, hip, hip, hourra !!!
Publié le 1 Janvier 2007
Maniac Cop
Au plus profond des ruelles endormies de New York, seulement éclairées par des réverbères dont la lumière peine à creuser l’obscurité, un détraqué travesti en flic zigouille une partie de la faune qui peuple la grosse pomme. Aux manettes, William Lustig fait le métier avec conviction. Mais c’est surtout la patte de Larry Cohen que l’on retrouve dans ce Maniac Cop, mi-horreur, mi-action movie, qui suit à la lettre le cahier des charges que le scénariste Cohen s’impose toujours, c'est-à-dire de ne jamais impatienter le spectateur grâce à une histoire qui file sans répit et limite les scènes de bavardage au maximum. On n’oubliera pas de noter également la superbe genèse du Maniac dans un flash back impitoyable sur fond de comptine angoissante. Un film extrêment riche et distrayant, qualités auxquelles il faut évidement ajouter Robert Z’Dar, l’incroyable interprêtre de Matt Cordell, qui offre a son rôle sa gueule à faire plus peur sans maquillage qu’avec, son regard déserté par toute lueur d’intelligence, et sa mâchoire disproportionnée de carnassier. Sa performance est inoubliable, tout comme ce film peu bavard, bourrin, tragique et premier degré qui soulève l’enthousiasme tant Maniac Cop s’assume comme un pur divertissement estampillé eighties. Chapeau bas messieurs !
Publié le 1 Janvier 2007
Pages |


















![La Nuit de la comète [Édition Collector Blu-Ray + DVD + Livret] La Nuit de la comète [Édition Collector Blu-Ray + DVD + Livret]](https://www.horreur.net/sites/default/files/styles/vertical-grand/public/upload/nuitcomete_bd_rimini.jpg?itok=cfnFyIUX)