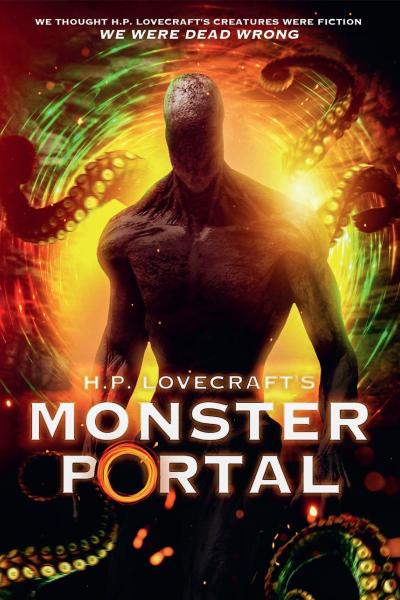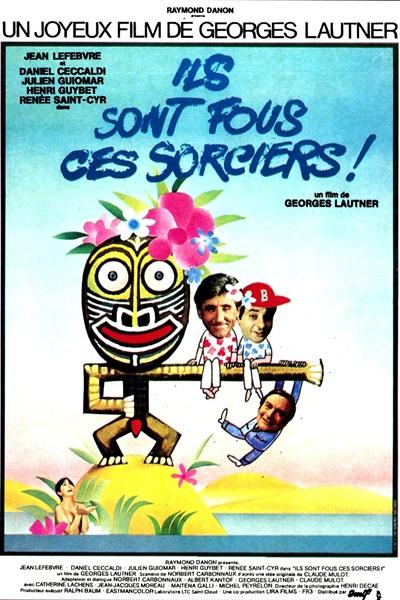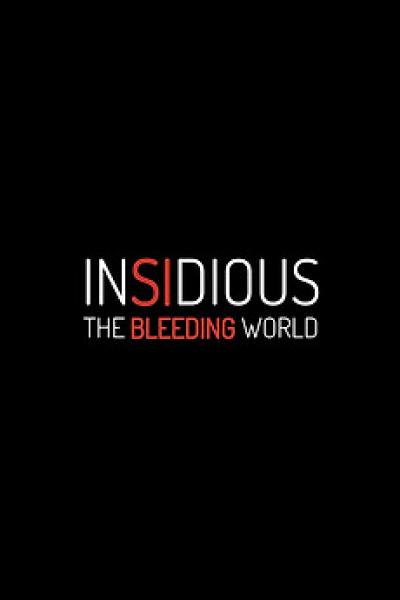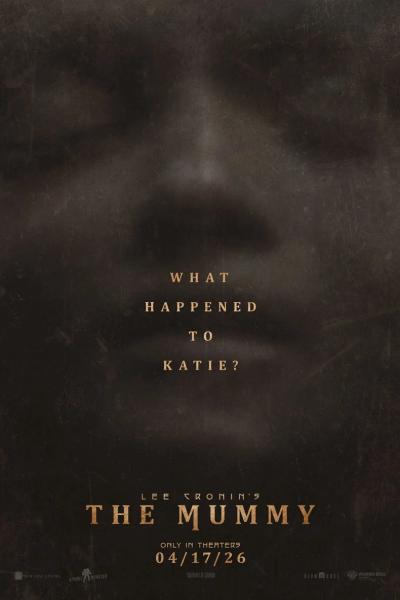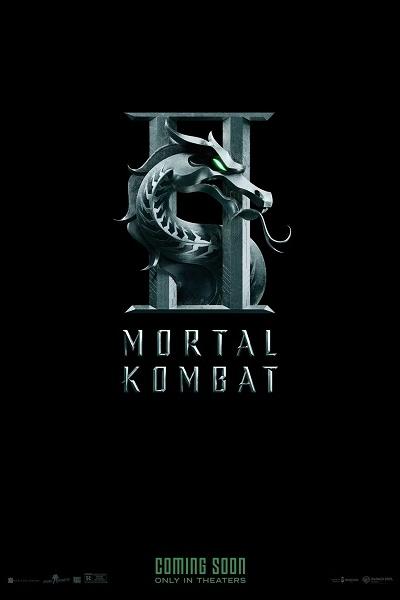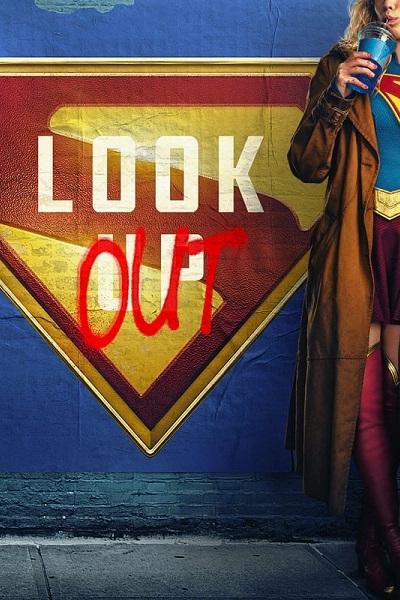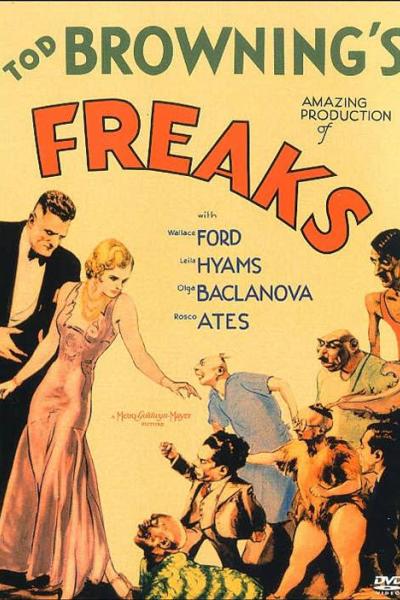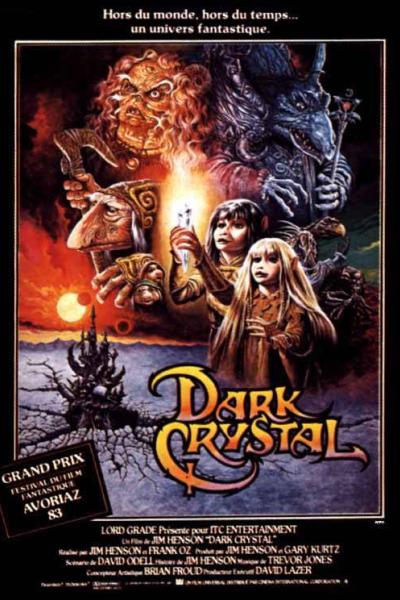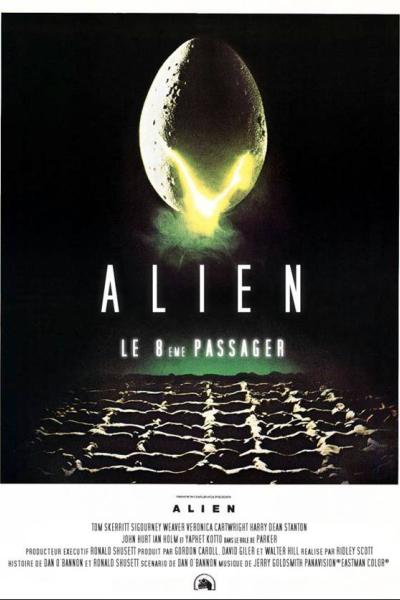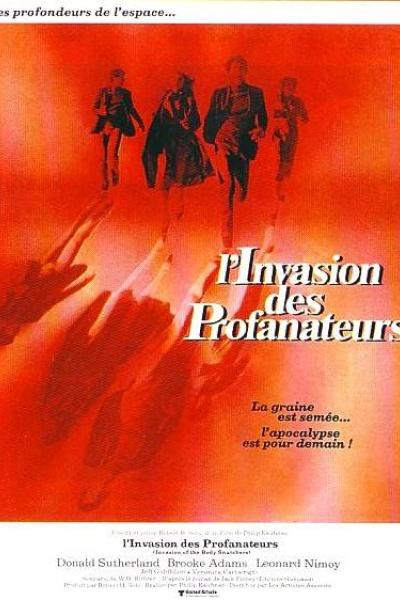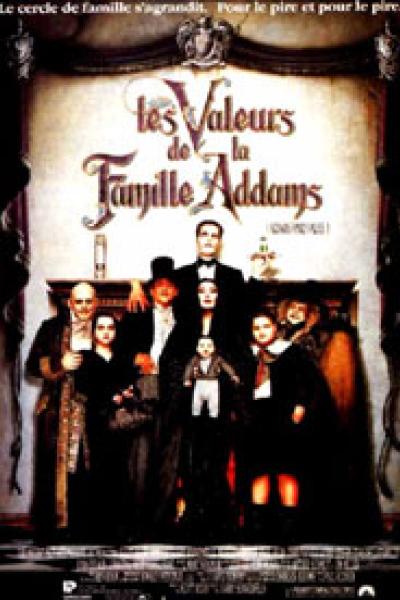Xan Cassavetes (qui n’est autre que la fille de John Cassavetes, le réalisateur des célèbres Gloria et Meurtre d’un bookmaker chinois dans les années 70) présentait son premier long-métrage, Kiss of the Damned, film de vampires doté d’un casting très français. A la fois hommage au giallo (par le biais, notamment, du magnifique score composé par Steven Hufsteter) et film de vampires, le long-métrage de Xan Cassavetes souffre d’un scénario bancal et convenu qui tranche avec l'onirisme véhiculé par la mise en scène. Paulo, scénariste en panne d’idées, locataire d’une maison dans un bled perdu des Etats-Unis, tombe sous le charme de la mystérieuse Djuna. Lorsqu’il découvre qu’elle est en réalité un vampire, Paulo accepte de se laisser mordre pour pouvoir partager sa vie. Le couple est heureux mais Djuna va devoir faire face à sa sœur, Mimi, en recherche perpétuelle de nouvelles proies. Cette dernière va peu à peu s’immiscer dans la vie du couple. Et c’est précisément pour cette raison que le premier film de la réalisatrice pose problème : la mise en scène extrêmement léchée vient soutenir une histoire de triangle amoureux à peu près aussi passionnante qu’un épisode d’Amour, gloire et beauté. Ainsi, bien que certaines séquences induisent un effet vaporeux plutôt réussi, le formalisme du film le fait peu à peu ressembler à une publicité mièvre et pudibonde. Au final, si la beauté plastique du film est incontestable, il est fort regrettable que Xan Cassavetes n’ait pas donner davantage de consistance à ses personnages. Un peu à la manière d’Amer ou de Berberian Sound Studio, que nous avions découverts à Gérardmer ces dernières années, le film de Xan Cassavetes verse dans un formalisme glacial qui empêche toute réelle sensualité – alors que c’est précisément l’un des éléments structurants du giallo.

Malgré ses défauts, le film de Xan Cassavetes était tout de même largement plus intéressant qu’APP, de Bobby Boermans. La jeune Anna, étudiante en psychologie, découvre, après une nuit de fête particulièrement arrosée, l’existence d’une nouvelle application sur son téléphone portable, Iris. Contagieuse, ineffaçable, l’application sème peu à peu la terreur autour d’elle, diffusant des messages textuels compromettants, contaminant les téléphones de l’université, et provoquant indirectement plusieurs incidents mortels. Le problème central du film de Boermans est de n’être qu’un thriller profondément soporifique, parfois même incompréhensible. La facture du film, loin d’être irréprochable, plombé par un montage parfois illisible (notamment dans les rares séquences d’action), ne relève donc pas le niveau d’un scénario à peu près aussi passionnant qu’un épisode de L’Inspecteur Derrick. Les personnages, assez mal interprétés, sont tous plus caricaturaux. Le spectateur assiste ainsi à un jeu de dupes inintéressant, jusqu’à un final à la limite du risible au cours duquel les masques tombent de façon incompréhensible. L’épilogue déconstruit le peu de crédibilité du scénario, expliquant en trois phrases le nœud de l’intrigue – jusque là relativement confuse, il faut bien l’admettre. Mais les défauts du long-métrage dépassent le film à proprement parler. Car APP repose également sur un dispositif superfétatoire suivant lequel le spectateur armé d’un Smarphone peut télécharger une application qui lui permettra, tout au long du film, d’obtenir des informations de nature à densifier son expérience cinématographique. Et, il faut bien l’avouer, si l’expérience proposée aurait pu être sympathique, elle n’est ici d’aucun intérêt, dans la mesure où le dispositif ne propose rien de singulier. Le « deuxième écran » n’offre que des informations redondantes par rapport aux éléments développés sur la toile. Bref, un gadget artificiel qui plombe encore davantage la projection.
Notons que, pour la première fois, le FEFFS proposait un film d’animation en compétition officielle, Una historia de amor e furia, du brésilien Luiz Bolognesi, Grand Prix du dernier Festival du Film d’Animation d’Annecy. Le récit retrace l’histoire du Brésil depuis le XVIème siècle, au travers du personnage d’Abeguar, combattant pour la liberté, en quête de l’amour de sa vie, Janaina. Le film relate quatre épiodes de l’histoire brésilienne : la situation des Indiens Tupinamba aux prises avec les conquistadors au cours du XVIème siècle, l’esclavage au cours du XVIIIème siècle, la lutte révolutionnaire contre la dictature militaire dans les années 60, et le combat pour la survie de l’humanité et le partage de l’eau potable dans un futur apocalyptique, en 2096. Le récit expose successivement ces quatre périodes du point de vue des mêmes personnages, Abeguar et Janaina, proposant par ce truchement une évocation de l’éternel retour au travers de deux concepts universels, le désir de liberté et la recherche de l’amour. De cette manière, Una historia de amor e furia épouse le problématique du récent et somptueux Cloud atlas des Wachowski. Le moteur du devenir historique serait ainsi conditionné par la soif de liberté consubstantielle à l’être humain. Cependant, contrairement au film des Wachowski, ce n’est pas le langage cinématographique à proprement parler qui donne vie à la problématique proposée, mais l’exposition successive, simpliste et répétitive, des quatre périodes historiques. Là où les Wachowski parvenaient, par un montage d’une minutie folle, à enchâsser les diverses histoires de ses personnages dans le devenir de l’humanité toute entière, le film brésilien se contente de parallèles grossiers qui, repris quatre fois de suite, deviennent redondants. Si certaines séquences restent, du point de vue l’animation, plutôt bien foutue, le discours global du film est trop schématique pour susciter l’immersion du spectateur.

Pourtant, il faut bien admettre que le film d’animation brésilien restait tout de même plus touchant que Love Eternal, de l’irlandais Brendan Muldowny, dont le thème central est pourtant le deuil du point de vue d’un jeune homme effacé et mutique. Ian, dont les parents meurent tour à tour, semble inapte à toute émotion. Au moment où il tente lui-même de mettre fin à ses jours, il trouve la dépouille d’une jeune femme, fraîchement décédée. Emu par la lettre qu’elle a laissée, Ian ramène le corps chez lui, s’endort à ses côtés et sent ses émotions se raviver. Thème complexe que celui de la mort, d’autant plus lorsque le réalisateur tente de l’investir avec une poésie beaucoup trop calculée pour susciter l’émotion. Love Eternal tente de capter l’émotion de la mort et du suicide à hauteur d’homme. Or, le problème essentiel du film réside dans le peu d’empathie que suscite le personnage principal. Pour cette raison, le spectateur risque d’avoir un mal fou à intégrer émotionnellement le récit ; les motivations du protagoniste vecteur, Ian, sont précisément trop obscures pour susciter l’adhésion du spectateur. De surcroît, alors même que le film prétend traiter une telle thématique d’une façon différente, moins conventionnelle, les personnages de femmes suicidaires qu’il nous présente constituent de telles caricatures qu’il est difficile d’être touché par leur destin tragique. Au final, si l’atmosphère est de prime abord plutôt joliment posée, et si la facture d’ensemble est loin d’être ratée, le réalisateur faisant preuve d’un réel sens du cadre, le traitement des personnages est à la fois trop distancié et trop caricatural pour convaincre.
Au final, la sixième édition du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg nous a donc permis de découvrir quelques œuvres particulièrement intéressants, que ce soit All Cheerleaders Die, de Lucky McKee, Nos héros sont morts ce soir, du français David Perrault, ou encore The Returned, de Manuel Carballo, malheureusement reparti sans la moindre récompense. Etant donnée la qualité des films présentés cette année, le festival de Gérardmer a désormais un concurrent de taille en matière de cinéma fantastique dans l’est de la France.














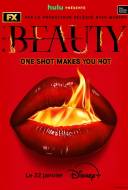







![28 Ans Plus Tard [4K Ultra HD Boîtier SteelBook limité] 28 Ans Plus Tard [4K Ultra HD Boîtier SteelBook limité]](https://www.horreur.net/sites/default/files/styles/vertical-petit/public/upload/28ansplustard_bduhd.jpg?itok=vn_bkDqH)